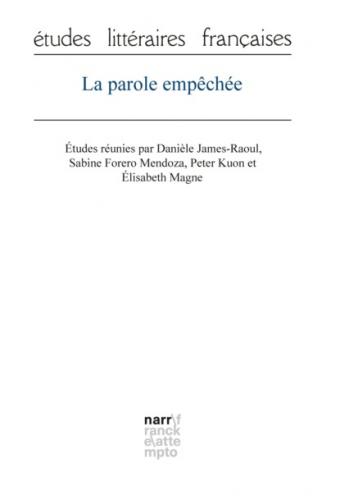De plus, cette abolition temporelle entraîne une fixation sur le passé, c’est-à-dire sur le ressenti (émotionémotions, souvenirs) de l’enfant, qui permet de bloquer toute explication, puisque tout passe par les yeux et la compréhension, évidemment, limitée du tout petit garçon. Ainsi, le narrateur déclare : « Un jour pourtant, ma sœur se retrouva à la maison. Quand et comment elle était arrivée, qui l’avait amenée, je ne le sus jamais ou je ne m’en souviens plus. Je me souviens seulement de la tristesse et du silence qu’elle apporta avec elle » (p. 88). Notons deux éléments distincts : le « je ne le sus jamais » n’équivaut pas à « ou je ne m’en souviens plus ». Il est évident qu’à un moment ou à un autre, le narrateur a « su ».
L’auteur fait donc en sorte de « piéger » le lecteur en concentrant la connaissance des faits sur le seul souvenirsouvenir provenant de l’enfance ; et, élément plus important, ce souvenir est d’ordre affectif (« tristesse et silence »). C’est là un moyen très habile de focaliser son attention sur le silence (le secretsecret), et sa sensibilité sur la tristessetristesse enfantine, deux ingrédients qui donnent sa force au récit : la parole empêchée laisse l’interrogation ouverte, et la peine de l’enfant – devant ce qu’il voit mais ne comprend pas – suscite une profonde émotionémotion, et cela sans recours à un pathos quelconque.
Force est donc de constater la portée indéniable de cette fausse naïveté, expédient narratif auquel le lecteur se laisse entièrement prendre, dans une espèce de jeu constant entre secretsecret cachécaché et dévoilementdévoiler. Nous l’avons déjà mentionné, la parole empêchée, ce non-ditnon-dit lourd de sens, trouve toute sa valeur dans le regard, ou plus exactement, dans le souvenirsouvenir de ce qui a été vu.
Dès le début de la nouvelle, le ton est donné : « Au souvenirsouvenir de ma mère s’ajoutait l’imageimage de cette sœur… » (p. 85) ; « Je me souviens seulement que la rivière [la rivière fatale] s’ouvrait devant moi comme quelque chose d’infini… » (p. 87) ; « Je me souviens seulement de la tristessetristesse qu’elle apporta avec elle… ». De la sorte, et en nous soumettant à la convention que l’intrigue passe par les yeux de l’enfant, nous observons que la narration se fait le conservatoire de la mémoiremémoire, une mémoire qui ne livre pas la parole mais son substitut, l’image, les images du passé.
Ces images sont de trois types, les images « scènes de jeux d’enfant » auxquelles se mêle l’admiration du petit garçon pour sa sœur aînée, si belle ; les images d’affliction (la sœur cloîtrée, son cadavre) ; mais surtout les images d’une réalité sublimée où la parole enfin libérée se confond avec une vision :
Elle me dit soudain : « Regarde comme c’est beau là-dedans ». Je me penchai pour mieux voir. Le puits entouré de lauriers roses apparaissait au premier plan, derrière venait la tache noire d’un cyprès élancé, ensuite, verdoyaient les arbres du jardin, et en arrière-plan brillait, au fond, une mince bande de rivière. Maintes fois j’avais vu se refléter dans la vitre cette imageimage du vallon ; mais, à cet instant ; comme je me penchais vers ma sœur […] il me sembla que cette image qui s’offrait dans la vitre, je la voyais avec les yeux affligés de ma sœur. Je restais muetmuet à regarder et je me souviens que cet endroit connu me fit l’effet d’un monde inconnu et nouveau, étrange et magique. « C’est seulement là que le monde est beau », reprit ma sœur. Ce furent les derniers mots que je lui entendis prononcer. (p. 89)
Plusieurs éléments retiennent notre attention : l’importance du « voir », la mention affirmée du souvenirsouvenir et, tout principalement, la transfiguration de la réalité en un monde sublime.
En effet, sur ce dernier point, on peut se demander quel est l’intérêt, pour l’économie du récit, de se livrer à une telle description, qui n’apporte rien de plus au déroulement de la narration des faits. Et pourtant, c’est là que réside l’essentiel de la nouvelle. Le paysage vu dans la vitre, on l’aura remarqué, est décrit comme un tableau, avec mention des divers plans. De plus, il se voit qualifié de nouveau et d’inconnu. Enfin, c’est ce monde sublime, celui de l’art (puisqu’il s’agit d’une représentation), qui libère la parole de la sœur, libération qui marque la victoire de l’art sur un réel particulièrement cruel et destructeur. Et le narrateur participe à cette vision de la transfiguration de la nature par l’art, puisqu’il reconnaît « voir à travers les yeux de sa sœur », cependant que sa parole à lui reste encore empêchée.
Néanmoins, ce même narrateur, tout en affirmant la puissance du souvenirsouvenir comme conservatoire, confère à l’art sa valeur de victoire sur le temps et sur les vicissitudes du réel. Les propos suivants terminent la nouvelle, pour la première fois au présent : « Je n’ai pourtant jamais oublioublié le visage de ma sœur. Je le revois toujours penché devant la vitre de la vieille maison, là où maintenant je me penche parfois, moi aussi, pour voir, l’espace d’un instant, comme le monde est beau » (p. 90).
Le souvenirsouvenir, à travers la réactualisation de l’imageimage de la sœur, par la fusion entre le « voir » du souvenir (« je le revois toujours ») et le « voir » du réel (« pour voir, l’espace d’un instant »), et enfin la fulgurance de l’image artistique, qui transforme le quotidien en beauté ; tels sont les substituts qui assurent, d’une certaine manière, la victoire finale de la parole, puisque, si la vision du jardin transfiguré libère la parole de la sœur, le souvenir et la commémoration de la vision réitérée par le narrateur sont – on l’aura bien entendu compris – les ingrédients mêmes de la nouvelle, qui, par essence, est Verbe, et assure à la parole, fût-elle empêchée, sa pérennité.
En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que le non-ditnon-dit volontaire, qui s’applique aussi bien à « l’événement » (le secretsecret) qu’au « nom » de la sœur (un nom qu’on voudrait effacer), ainsi que l’abolition de son imageimage par le père (disparition de la photographiephotographie), tous ces éléments se heurtent à la toute-puissance d’une fiction qui assure la pérennité de ce qui aurait dû être aboli, par la puissance du souvenirsouvenir et par la transfiguration opérée par l’art.
Nous ne connaîtrons jamais le nom de la sœur. C’est sans doute mieux ainsi. D’une part, comme le signale DeleuzeDeleuze (Gilles), dans son commentaire ProustProust (Marcel) et les signes, « [l]es noms propres eux-mêmes ont un contenu inséparable des qualités de leurs syllabes et des associations libres où ils entrent »3. Par voie de conséquence, la confrontation entre le nom et la personne crée, sans doute, un hiatus générateur de déception, déception qui est ici évitée. D’autre part, la sœur sans nom restera, pour nous lecteurs, un personnage hors du réel, elle restera, comme un archétype, la sœur, une figure de fiction, artistique et intemporelle.
Bouches cousues : mutisme, violenceviolence et murmure dans les romans de Carole MartinezMartinez (Carole)
Agnès Lhermitte (Université Bordeaux Montaigne, EA 4593 CLARE)
« Au théâtrethéâtre de la mémoiremémoire, les femmes sont ombre légère », écrit l’historienne Michelle Perrot dans Les Femmes ou les Silences de l’Histoire1. C’est dire que le rôle qu’on leur concède dans la marche du monde manquemanque de consistance et de poids. Bien souvent, il s’agit même d’un rôle muetmuet. Mais la romancière contemporaine Carole MartinezMartinez (Carole) prétend que si, « depuis la Genèse et le début des livres, le masculin couche avec l’Histoire », pour qui sait prêter l’oreille, « il est d’autres récits. Des récits souterrains transmis dans le secretsecret des femmes, des contes enfouis dans l’oreille des filles, […] des paroles bues aux lèvres des mères »2. Dans ses deux romans, elle entend ainsi rendre à deux de ces figurantes effacées corps de chair, mouvement, et surtout parole. Elle a tiré des oubliettes de l’Histoire deux femmes obscures que leur destin avait bâillonnées. Tirée de la légende