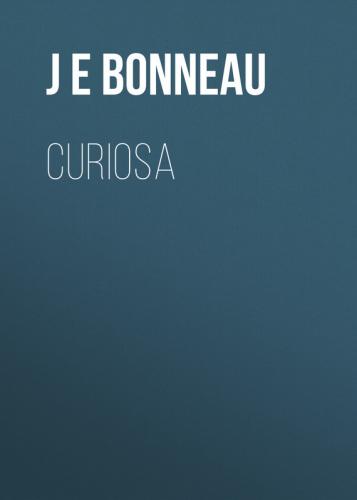La Renaissance, dès son aurore, s’annonce comme un retour plus ou moins franc, mais très réel et très spontané au Paganisme, une revanche de longs siècles d’oppression et d’abrutissement. Tel ne prétend que retrouver les titres perdus de l’humanité, restaurer les lettres Grecques et Latines, qui, sans le vouloir, se refait païen. Remettre en honneur les langues d’Homère et de Platon, de Cicéron et de Virgile, c’était en effet renouer une chaîne que le Moyen Age croyait avoir brisée pour jamais, rendre l’essor à la pensée et faire rentrer dans le néant les sciences fausses et stériles. Dérouler le tableau des civilisations et des arts de l’Antiquité, c’était poser les termes d’une comparaison bien périlleuse et montrer au grand jour l’effroyable abaissement, l’ennui mortel où le catholicisme avait plongé le monde. Les Vertus théologales faisaient maigre figure à côté des trois Grâces, et il suffisait de songer aux Dieux de l’Olympe, à ces Dieux toujours jeunes, souriants et robustes, ardentes personnifications des phénomènes naturels, des forces génératrices et des joies de la vie, immuablement assis dans leur sérénité lumineuse, pour faire prendre en dégoût ce culte de l’agonie et de la souffrance, qui étale partout l’image lamentable d’un Dieu supplicié. Qu’est-ce en effet que le catholicisme du Moyen Age, sinon l’abolition de la vie, la religion du sépulcre? L’homme est fait pour être mangé des vers; il n’a pas été créé pour agir, mais pour prier. Arrière donc la science, l’étude; arrière la famille, la patrie, toutes les grandes et nobles affections humaines: ce sont autant de faces du Diable, qui en peut prendre des milliers. L’homme ne doit penser qu’à une seule chose, à son salut; se demander perpétuellement, jour et nuit, serai-je damné? s’absorber dans l’espoir des joies paradisiaques réservées aux élus ou dans la crainte de l’enfer qui l’attend, s’il trébuche. Agir, inventer, chercher le progrès, le bien-être, développer sa volonté et son énergie, se laisser prendre au piège de l’ambition, de l’amour, de la poésie, de l’art, c’est folie; il n’y a de vrai que le tombeau et, par derrière, la vie éternelle. Quelle violente envie de rompre ce réseau de momeries lugubres et de pratiques asservissantes devait tourmenter ceux qui se sentaient faits pour vivre, pour penser et pour agir! Comme ils devaient aspirer à se voir délivrés d’une religion qui, sous prétexte de mater la chair, privait l’homme de tout ce qui peut le charmer, l’épouvantait, le terrifiait pour le rendre plus docile et le forçait d’user son intelligence à résoudre des questions ineptes ou insolubles! Combien durent être de cœur avec ce Grec enthousiaste qui s’écriait: «Cela ne peut pas durer; revenons-en aux Dieux d’Homère!»
Boccace est un païen par l’ardeur sensuelle, par le culte de la grâce, de la beauté, surtout par le mépris de la mort et de ses terreurs, si chères à l’Église dont elles remplissent l’escarcelle. Pendant que la peste ravage Florence, que le glas sonne, conviant à la prière, invitant à se couvrir du sac de cendre, il rassemble ses jeunes femmes et ses galants cavaliers dans une délicieuse villa qui rappelle les frais ombrages de Tibur, et il leur fait mettre en pratique le carpe diem des poètes Épicuriens. Si la Mort arrive, elle les surprendra le sourire aux lèvres et se passant la couronne de fleurs qui chaque jour désigne le Roi ou la Reine du festin. Ce qui, pour un autre conteur, n’aurait été qu’un cadre ingénieux, devient ici l’œuvre même et lui donne un sens. Dans ce cadre, Boccace a déroulé en cent histoires puisées un peu partout, mais rajeunies avec un art suprême, la vaste épopée héroïque, galante, libertine, tragique ou railleuse que chantent les passions dans le cœur de l’homme: la haine, la jalousie, la vengeance et surtout l’amour, qui les inspire toutes. Paladins des anciens âges que l’on croirait détachés du Cycle d’Artus et de la Table-Ronde, tyrans farouches taillés sur le patron des Ugolin et des Ezzelino, maris débonnaires ou féroces, amants audacieux et entreprenants, gros marchands pleins d’astuce ou de bêtise, prêtres hypocrites, moines enragés de hâblerie et de luxure, Boccace nous présente l’homme sous toutes ses faces; comme peintre de femmes, il est sans rival. Quelle gracieuse galerie de filles d’Ève, avant ou après la pomme! La Laure de Pétrarque, la Béatrix de Dante sont des êtres vaporeux, insaisissables; les autres idéales figures qui traversent l’épopée du sombre Florentin, la tragique Francesca de Rimini, avec sa plaie au flanc, parcourant l’espace enlacée à son Paolo, la languissante Pia de’ Tolomei, fleur fanée dans l’air étouffant des Maremmes, sont des ombres plutôt que des femmes. Celles de Boccace ont plus de corps: elles ont même un corps assez épais, ces grosses et grasses matrones sur lesquelles s’assouvit sans vergogne l’appétit monacal; ces rusées commères si adroites à passer d’un lit dans un autre, à duper leurs maris, à leur boucher le bon œil, à les occuper dans le cuvier pendant que le galant les cajole; ces fringantes courtisanes toutes roides dans leurs robes de brocart et d’une impudence intrépide. L’artiste épris de la beauté des formes comme un païen, un Grec du temps de Praxitèle et de Parrhasius, se révèle en caressant d’un libre pinceau des nudités chatoyantes: la douce et charmante Grisélidis, si jolie en costume d’Ève; la veuve innocente qui, dupée par un facétieux étudiant, s’en va au clair de lune, déshabillée comme une nymphe du Giorgione, guetter sous la feuillée les célestes Demoiselles qui doivent lui ramener son amant; Geneviève et Isola, blondes comme fil d’or, aux cheveux bouclés, entremêlés d’une légère guirlande de pervenche, viennent pêcher dans le vivier, sous les yeux du Roi de Sicile, et montrent ingénument sous la chemise de lin leurs charmes naissants; dans la forêt de Ravenne, une femme court toute nue et rose à travers bois, talonnée par la meute, poursuivie par le féroce veneur qui sonne du cor à pleins poumons. Dante, le fervent et mystique Chrétien, eût fait de ce supplice l’expiation de quelque crime; il eût cinglé de ses tercets, comme d’un fouet à triple lanière, les épaules de l’épouse adultère ou de la maîtresse infidèle; mais Boccace est un Épicurien: la suppliciée n’est coupable que de vertu, elle a osé résister à l’amour! Peut-être Boccace a-t-il dit son dernier mot sur la femme dans l’histoire de cette séduisante Alaciel, qu’on ne peut voir sans la désirer, qu’on se dispute à coups de couteau, qui passe des bras de celui-ci dans ceux d’un autre, de la cabine des matelots dans le harem d’un pacha, goûte l’amour des vieux et des jeunes, des princes et des voleurs, au milieu de toutes sortes d’enlèvements et d’aventures, puis revient fraîche et souriante à son fiancé, le roi de Garbe, comme si de rien n’était: Bouche baisée ne perd pas de son charme, mais se renouvelle, comme fait la lune.
Ces contes, qui ne sont pas tous aussi voluptueux et où la licence ne tient d’ailleurs pas plus de place qu’elle n’en occupait alors dans les mœurs, nous sont précieux encore à un autre titre: ils ont servi de passeport à la libre-pensée. Il fallait constamment se tenir en garde contre une théologie ombrageuse, pour qui la pensée était suspecte et qui surveillait d’un œil jaloux tout ce qui pouvait faire échec à ses enseignements. Quand Boccace prit la plume, Cecco d’Ascoli venait d’être brûlé. Les temps n’étaient pas encore mûrs pour la discussion philosophique; mais s’il est défendu de raisonner, on peut toujours