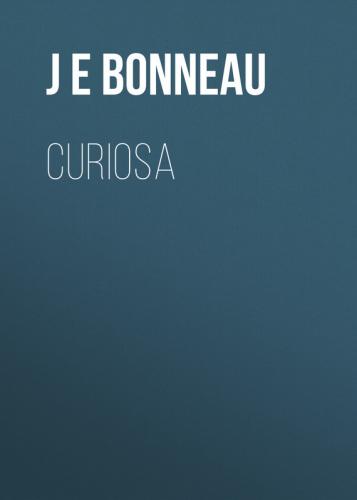Laissons donc à Valla ce qui lui appartient bien, le mérite d’avoir le premier dévoilé la fraude, et par des arguments propres à la rendre désormais insoutenable. Cela aurait pu lui coûter assez cher. Ayant eu l’imprudence de revenir à Rome, en 1452, il faillit être assassiné, sur le simple soupçon d’avoir écrit ce livre abominable, qu’il s’était contenté de lire à ses amis de Naples, et qu’il gardait prudemment par devers lui, sans le publier; il dut s’enfuir sous un déguisement, s’embarquer et gagner l’Espagne, pendant qu’on instruisait son procès.
Le De falso credita et ementita Donatione Constantini ne fut réellement connu, divulgué, qu’après sa mort et surtout lorsque Ulrich de Hutten l’eut édité pour la première fois, en 1517, à l’aide de presses clandestines établies dans son château délabré de Steckelberg, pour le dédier à Léon X. Luther apparaissait alors sur la scène du monde, et cette virulente négation de droits jusqu’alors réputés inébranlables servit de machine de guerre à la Réforme contre la Papauté. «J’ai entre les mains,» écrivait Luther, «la Donation de Constantin réfutée par Valla, éditée par Hutten. Bon Dieu! que de ténèbres ou de perversités accumulées par Rome! Vous serez stupéfait que Dieu ait permis, non seulement que cela durât pendant des siècles, mais que cela prévalût, que des mensonges aussi infâmes, aussi grossiers, aussi impudents fussent insérés dans les Décrétales et imposés comme des articles de foi35.» Cette première édition, fort rare, est précédée d’une ironique dédicace à Léon X. «Ceux-là ne te connaissent pas, Saint-Père,» lui disait plaisamment Hutten, «qui croient que tu ne sauras pas apprécier le travail de Laurent Valla. Tu affirmes que tu veux rendre la paix au monde: il n’y a pas de paix possible tant que les ravisseurs n’auront pas restitué aux possesseurs légitimes ce qu’ils leur ont injustement pris.» Léon X lui répondit à sa manière, en ami des arts sinon en ami des lettres, et d’une façon qui, pour être détournée, n’en affirmait pas moins une fois de plus l’attachement obstiné de la Papauté à ses titres chimériques. Il commandait à Raphaël, outre la Bataille du pont Milvius, dont le sujet véritable, au point de vue catholique, est l’apparition miraculeuse du Labarum, deux immenses fresques: le Baptême de Constantin par Saint Sylvestre, et Constantin donnant Rome au Pape, qui ornent encore une des salles les plus splendides du Vatican.
Résumé brillamment et complété par Hotman, au XVIe siècle, réédité par Schardius, puis encore au XVIIe siècle par Banck, qui le donne comme une pièce capitale pour l’histoire des démêlés du Saint-Siège avec les puissances, le traité de Laurent Valla mérite assurément de ne pas tomber dans l’oubli. C’est une œuvre. L’auteur a extrêmement soigné, au point de vue de la composition et du style, ce pamphlet ou plutôt ce plaidoyer qui était pour lui un morceau de prédilection et qu’il retoucha jusque dans sa vieillesse. La forme en est légèrement artificielle, comme tout ce qui tient au genre oratoire et demande de la symétrie; mais la langue est pure, puisée aux bonnes sources, digne de celui qui avait recueilli et commenté les Élégances de la langue Latine. Les premières pages sont toutes Cicéroniennes. Laurent Valla y prête successivement la parole, avec une grande ampleur, aux fils et aux amis de Constantin, au Sénat, au Peuple, qui tous le supplient de ne pas donner l’Empire; enfin à Sylvestre, qui refuse de le recevoir, et il a placé dans la bouche de ces différents personnages les raisons les plus propres à faire toucher du doigt les impossibilités matérielles et morales soit de la Donation, soit de son acceptation. Ce ne sont pas là de vaines tirades déclamatoires, des morceaux de rhétorique plus ou moins achevés; la forme oratoire ne nuit en rien à la vigueur des arguments, et, sous l’abondance du style, la cadence des périodes, l’éclat et la hardiesse des figures, des apostrophes, on sent une robuste dialectique, comme des muscles solides sous une draperie. Le discours de Sylvestre surtout est remarquable. Tous les motifs du refus qu’il le suppose faire, avec une malicieuse bonhomie, tirés de la prédication et de l’enseignement de Jésus, des Épîtres de Saint Paul, des écrits des Pères, appliqués avec une rare justesse, s’appuient sur des textes qu’on ne peut guère écarter; mais c’est une ironie bien cruelle que de placer dans la bouche d’un Pape cette audacieuse contre-partie des prétentions de Grégoire VII, fondées sur des allégories de la Lune et du Soleil. Ces polémistes du XVe siècle étaient de rudes jouteurs, et, en pareilles matières, leur connaissance profonde des lettres sacrées les rendait bien redoutables. L’Église, maîtresse de l’instruction publique, lui donnant pour base l’étude des livres saints, pour couronnement celle de la théologie et du droit canonique, formait sans doute des prêtres instruits et se préparait des apologistes; mais elle se créait aussi de dangereux adversaires en ceux qu’elle nourrissait ainsi de sa moelle et que venait à éclairer un rayon de libre pensée. Ce sont des théologiens qui lui ont fait le plus de mal.
La discussion proprement dite de l’acte incriminé se trouve dans la seconde moitié du livre; elle est mordante, acharnée, spirituelle; le polémiste, auquel M. Nisard lui-même reconnaît pour habitude «d’alléguer des raisons avant de dire des injures,» y redouble d’invectives, mais le «grammairien» surtout, éplucheur de mots et de syllabes, y triomphe. Valla, et ce n’est point son moindre mérite, a ouvert la voie à la critique diplomatique, un art encore en enfance à son époque, et que l’Église n’était guère tentée de protéger. Toute brillante et passionnée qu’elle est, sa discussion repose sur un examen approfondi du texte, au point de vue historique comme au point de vue grammatical; il passe tout au crible avec un soin minutieux, et si l’on analyse les moyens de vérification qu’il emploie pour saisir les traces de fraude, on se convaincra que les Mabillon et les d’Achéry n’en ont point eu d’autres: ils ont précisé et formulé les règles que Valla appliquait d’intuition.
Février 1879.
IX
LES CONTES
DE VOISENON36
L’Abbé de Voisenon est une originale figure du XVIIIe siècle. Presque aussi laid qu’un singe, d’une taille petite et rabougrie, la mine chétive, envahie d’une jaunisse perpétuelle, bâti par la nature dans un moment de distraction, d’une santé délabrée, avec cela, et de temps en temps, étouffé par un asthme qu’il prétendait tenir de sa nourrice, il ne laissa pas d’être un homme à bonnes fortunes; c’était un abbé galant, un coureur d’alcôves. Ne rappelons pas qu’à vingt-cinq ou vingt-six ans il avait été grand-vicaire, ce qui nous est au moins aussi indifférent qu’à lui-même, et que sur son refus d’accepter l’épiscopat, il reçut l’abbaye royale du Jars, près de son château de Voisenon, avec trente mille livres de rente: entré dans les lettres sous les auspices de Voltaire, il nous est rien que pour cela sympathique, et s’il conserva de fructueux bénéfices en restant fidèle à cette amitié de sa jeunesse, il en aurait obtenu bien d’autres en passant dans le camp des