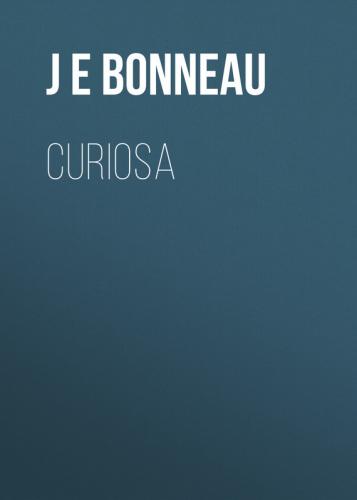Les grandes maisons du XVIIIe siècle avaient pris un instant la mode de donner ce qu’on appelait des journées de campagne, où elles offraient à leurs invités des divertissements exquis et de toutes sortes. Crébillon, aussi bien et mieux qu’un autre, aurait pu nous retracer une de ces journées; mais avec sa finesse ordinaire, il s’est contenté d’en raconter l’épilogue. La dernière fusée éteinte, la dernière coupe de Champagne vidée, quand chacun s’est mis en quête de son appartement, il semble que tout soit fini; au contraire, tout commence. Ces sortes de réunions servaient de prétexte à des rencontres, à des arrangements fortuits; l’imprévu était de la fête. Cidalise s’est enfermée chez elle, mais elle a oublié de pousser le verrou; l’a-t-elle vraiment oublié? Clitandre, en simple robe de chambre de taffetas, erre par les couloirs, trouve une porte qui s’ouvre toute seule et pénètre chez Madame sans se faire autrement annoncer. Est-ce bien là qu’il croyait entrer, et Madame l’attendait-elle, si toutefois elle attendait quelqu’un? Autant de points qui restent dans l’ombre; Crébillon fils est le peintre des demi-teintes et l’homme des sous-entendus: il laisse plus à deviner qu’il ne donne à voir. La conversation s’engage, légère et spirituelle d’abord, puis de plus en plus intime; on se rapproche, on se fait des confidences. On se croyait invinciblement attaché de part et d’autre, et bientôt, à la manière dont Cidalise tout comme Clitandre parlent de leurs amours de la veille, ils s’aperçoivent que ce sont des amours déjà bien lointains, bien effacés, ils entrevoient qu’ils ne sont peut-être pas aussi indifférents l’un à l’autre qu’ils le supposaient. Crébillon fils est un maître en ce genre d’escrime amoureuse; les stratagèmes insidieux de l’attaque, les coquetteries de la défense, le trouble de la défaite, il nous a peint tout cela vingt fois, et toujours avec un art parfait, de nouvelles délicatesses de sentiment et de style. Ce sont des variations sur une seule corde, toujours la même, mais quelle corde! la fibre la plus déliée et la plus sensible du cœur humain.
Ce n’est pas d’ailleurs chose facile que de donner un intérêt croissant à un dialogue de ce genre, qui aurait au théâtre une durée de deux ou trois heures. En cela, Crébillon a plus d’une ressemblance avec Marivaux et semble souvent avoir voulu reprendre sous une autre forme, plus vive et d’une couleur plus chaude, le Jeu de l’amour et du hasard de son devancier. Tous deux sont du même monde et, à quelques années de distance, s’inspirent des mêmes modèles, raffinent les préciosités des mêmes salons. Mais l’auteur dramatique a, pour se soutenir, une intrigue qu’il emmêle et file jusqu’au dénouement, les allées et venues de la scène, les incidents qu’il lui plaît de créer: le romancier se sauve par la peinture des caractères et les descriptions. Crébillon fils, à la fois auteur dramatique et romancier dans ce petit livre, s’est volontairement privé des ressources de l’un et de l’autre. Une causerie qui parcourt tous les tons, qui commence par le badinage et finit par l’attendrissement, les progrès d’un sentiment, d’un caprice, d’une fantaisie que l’on voit naître et se développer, cela lui suffit pour éveiller la curiosité. Et que de jolies digressions, d’anecdotes lestement troussées, pour remplir les vides et amuser les entractes! Quoi, il fallait tant d’esprit, de ténacité, de persuasion et d’éloquence, des phrases si bien tournées, des compliments si adroits pour décider à l’indulgence une de ces femmes que l’on nous peint comme de fieffées impures! Le XVIIIe siècle est une époque calomniée.
«La vérité ne saurait être plus exacte,» dit Palissot, «que dans les romans de Crébillon fils, les caractères mieux tracés, les situations filées et graduées avec plus d’art. Ne l’accusons pas de la licence des mœurs qu’il a peintes, il pourrait dire à tout son siècle:
»Le comte Hamilton est le seul écrivain à qui Crébillon ait été comparé. Si Hamilton a donné dans ses Mémoires de Grammont un modèle de plaisanterie exquise que personne n’est tenté d’imiter, ses contes, quoiqu’il en ait fait de très agréables, n’ont pas à ce qu’il nous semble la gaîté piquante, ni l’originalité des romans de Crébillon, ni surtout cette vérité de mœurs qui les fera vivre tant qu’on sera curieux de connaître les Français du XVIIIe siècle. La réputation de ces romans peut, à la vérité, décroître par le changement qui s’est déjà fait dans nos habitudes, mais il sera toujours vrai que Crébillon a été l’historien le plus fidèle des mœurs de son temps.» Ce jugement doit rester; Crébillon n’est pas seulement un écrivain délicat, c’est un observateur pénétrant et un peintre fidèle. Par la nature du cadre qu’il s’impose généralement, il ne peut s’appesantir sur aucun caractère, sur aucune situation; il faut qu’il aille vite, que les tableaux se succèdent, et chaque personnage n’a que le temps de dessiner en passant sa silhouette. Toutes sont justes et précises, elles ne paraissent qu’effleurées et sont étudiées à fond. Ses portraits ont cette vérité et cette variété infinie que rencontrent seulement ceux qui peignent sur le vif; aucune de ses femmes ne ressemble à l’autre, n’a le même ton, le même visage, la même langue, et toutes cependant sont des rouées et des coquettes; elles ne diffèrent que par des nuances pour ainsi dire insaisissables: ces nuances, il les a saisies et fixées. Bien peu d’écrivains du même genre ont si finement arrêté les contours de physionomies fugitives et donné ce cachet de réalité aux filles de leur imagination.
Juillet 1879.
XI
LES NOUVELLES
DE SACCHETTI40
Les Trecento Novelle de Franco Sacchetti sont un des monuments de la littérature Italienne: comme style, de pur Toscan, elles font autorité et se classent parmi les testi di lingua; comme fond, elles ont l’inappréciable avantage d’être des tableaux de mœurs d’une vérité, d’une précision et d’une couleur on ne peut plus rares. Il y a lieu de s’étonner qu’elles soient restées manuscrites près de cinq siècles; presque contemporaines de Boccace, elles n’ont vu le jour que du temps de Voltaire. Les Italiens de la Renaissance les connaissaient pourtant à merveille; Strapparola, Bandello, le Lasca, Pogge surtout, en ont largement profité, mais l’idée de s’en faire l’éditeur n’est venue à personne de ceux qui les mettaient si bien à contribution. Peut-être était-ce par remords et pour ne pas dévoiler leurs larcins: croyons plutôt qu’ils les trouvaient d’un style trop rude, trop archaïque, et qu’ils préféraient de bonne foi à ces vieilleries leurs amplifications ou rajeunissements. Bottari les imprima le premier en 1724; Poggiali en donna une édition plus correcte et plus exacte (Livourne, sous la rubrique de Londres, 1795, 3 vol. in-8); à cette époque, le temps avait déjà produit dans l’œuvre de Sacchetti des ravages irréparables. Les copies en étaient encore nombreuses; il y en avait à Florence, à Rome, dans les bibliothèques publiques et dans les collections particulières; mais la plupart étaient de date récente, du XVIIe siècle ou de la fin du XVIe, et leurs auteurs ne semblaient avoir eu qu’une préoccupation: rajeunir le texte et lui enlever toute saveur, raccourcir ou délayer les Nouvelles, substituer leurs propres réflexions à celles de Sacchetti; ces copies ne pouvaient être d’aucune utilité. Un manuscrit ancien de la Bibliothèque