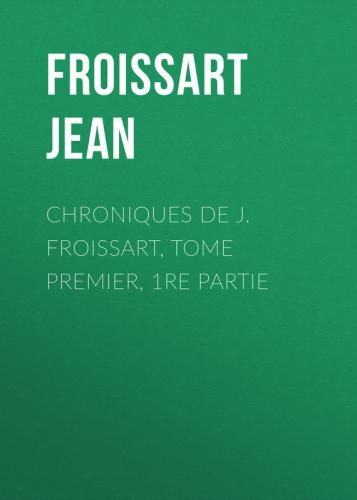Parfois même Froissart a transcrit mot à mot le texte du chanoine de Liége. On peut citer comme exemple l'admirable récit des derniers moments de Robert Bruce, la plus belle page peut-être de ce volume29: la foi qui a fait les croisades n'a rien inspiré de plus simple, de plus ému, de plus naïvement grand. Ni Villehardouin, ni Joinville n'ont atteint cette hauteur d'éloquence où l'on sent passer comme un souffle de la chanson de Roland. Malheureusement pour Froissart, tout l'honneur de cette page incomparable revient à Jean le Bel dont le chroniqueur de Valenciennes s'est contenté de reproduire le récit sans y rien changer. On en peut dire autant du célèbre passage où l'élévation de Jacques d'Arteveld30 est racontée avec tant de malveillance et de parti pris. Quel récit passionné, curieux même dans ses erreurs et ses injustices! Comme il respire bien l'étonnement, le dédain que dut éprouver la fière aristocratie des bords de la Meuse pour l'insolente tentative du chef des vilains de Flandre! C'est qu'en effet le véritable auteur du récit dont nous parlons n'est pas Froissart, mais le noble chanoine de Liége qui, n'allant à la messe qu'avec une escorte d'honneur de seize ou vingt personnes31, trouve bien impertinent cet Arteveld qui se fait accompagner de soixante ou quatre-vingts valets! Deux des récits les plus vantés de la première rédaction, l'épisode des amours d'Édouard III et de la comtesse de Salisbury, la narration du siége de Calais, sont aussi à peu près littéralement empruntés au galant et chevaleresque chanoine. On s'étonne moins de ces emprunts quand on admet comme nous que la rédaction où ils sont le plus fréquents et surtout le plus serviles a précédé les autres.
Sous quelle influence a été composée la première rédaction? Les dernières lignes du prologue fournissent la réponse à cette question: «… à la prière et requeste d'un mien chier seigneur et maistre monseigneur Robert de Namur, seigneur de Beaufort, à qui je vueil devoir amour et obéissance, et Dieu me laist faire chose qui lui puisse plaire!32» Robert de Namur figure dans deux autres passages de la première rédaction. Froissart nous apprend que «ce gentil et vaillant chevalier,» neveu de Robert d'Artois dont il portait le nom, au retour d'une croisade en Prusse et en Palestine, vint offrir ses services à Édouard III pendant le siége de Calais en 134633. Nous retrouvons Robert de Namur dans les rangs des Anglais en 1369 à cette chevauchée de Tournehem où il joue un rôle si brillant et dont il a dû fournir à notre chroniqueur les détails très-circonstanciés34. Robert, qui toucha jusqu'à la mort d'Édouard III en 1377 une pension de trois cents livres sterling sur la cassette de ce prince, avait encore resserré les liens qui l'unissaient au parti anglais en se mariant par contrat du 2 février 1354 à Élisabeth de Hainaut, sœur de la reine d'Angleterre. Il n'est donc pas étonnant que le jeune clerc de Philippe, revenu dans son pays après la mort de sa bienfaitrice en 1369, ait trouvé des encouragements auprès d'un personnage aussi chevaleresque et aussi dévoué à la cause anglaise que Robert de Namur.
On a prétendu que Froissart n'est entré en relations avec Robert de Namur qu'après 1373, à l'occasion du mariage de Marie de Namur, nièce de Robert, avec Gui de Blois. La seule raison qu'on donne, c'est que l'auteur du Joli buisson de Jonèce, poëme composé le 30 novembre 137335, n'a pas nommé Robert parmi ses protecteurs36. Quoiqu'il ne faille pas demander à une œuvre de poésie légère une précision en quelque sorte statistique et que l'on puisse signaler d'autres lacunes dans la liste du Joli buisson, l'omission du nom de Robert de Namur a néanmoins, on doit en convenir, quelque chose de frappant et de caractéristique. Faut-il y voir un simple oubli analogue à celui qu'allait commettre Froissart lorsqu'il dit:
Haro! que fai? Je me bescoce;
J'ai oubliiet le roy d'Escoce
Et le bon conte de Duglas37.
L'auteur de la rédaction dédiée à Robert de Namur aurait-il été peu satisfait de la récompense qu'il reçut de son travail, ou y avait-il alors quelque brouille entre Robert et Gui, le bon seigneur de Beaumont, pour lequel le poëte du Joli buisson, dès lors curé des Estinnes, témoigne cette déférence particulière que l'on rend à son maître et seigneur? Il serait téméraire de répondre à ces questions. Ce qui est certain, c'est que, quoique la première rédaction ait été composée à la requête de Robert de Namur, le nom de ce seigneur a été omis ou plutôt supprimé dans le prologue de tous les manuscrits revisés de cette rédaction, suppression bien plus surprenante que l'omission relevée dans le Buisson de Jonèce. Et pourtant on ne peut contester que les manuscrits où l'on trouve la révision ne soient postérieurs à ceux qui ne la contiennent pas et où l'on voit figurer le nom de Robert de Namur. A plus forte raison serait-on mal fondé à tirer de l'omission de ce nom dans un poëme une conclusion contre la date que nous avons assignée à la première rédaction.
D'après l'opinion que nous combattons, Froissart se serait attaché à Robert de Namur de 1390 à 1392, et il faudrait reporter entre ces deux dates la rédaction du premier livre, entreprise sous les auspices de ce seigneur. Mais cette hypothèse est entièrement gratuite, en opposition avec les faits les mieux établis et contraire à toute vraisemblance. Froissart dit en termes formels dans le prologue du troisième livre, composé précisément vers 1390, qu'il a pour maître et seigneur Gui, comte de Blois: «Et pour ce je sires Jehans Froissars, qui me sui ensoingnez et occupez de dicter et escripre ceste hystoire à la requeste et contemplacion de hault prince et renommé messire Guy conte de Bloys, mon bon maistre et seigneur38…» Depuis le jour où notre chroniqueur, devenu dès 1373 curé des Estinnes, où Gui de Châtillon possédait un fief dépendant de la seigneurie de Chimay, s'attacha par un lien étroit à la fortune et même au service de la maison de Blois, rien, absolument rien ne fait supposer que la protection dont cette illustre maison ne cessa de l'entourer se soit démentie un seul instant. Au contraire, dans le prologue du quatrième livre, Froissart apparaît pour la première fois investi d'un canonicat dont il était certainement redevable à la faveur du comte de Blois, seigneur de Chimay. L'auteur des Chroniques s'intitule dans ce prologue «presbiterien et chapelain à mon très cher seigneur dessus nommé (Gui de Blois) et pour le temps de lors tresorier et chanoine de Chimay et de Lille en Flandres.» Un des plus récents biographes de Froissart n'en a pas moins intitulé l'un des chapitres de son livre: Froissart chez Robert de Namur39. Il est vrai que l'on se borne dans ce chapitre à raconter divers incidents des dernières années de la vie de Robert mort le 18 août 1392, incidents qui n'ont rien à démêler ni avec la personne ni avec la vie du chroniqueur: on n'y trouve pas un mot d'où l'on puisse inférer que le chapelain de Gui de Blois ait vécu, comme on le prétend, de 1390 à 1392, auprès du pensionnaire, du partisan dévoué des Anglais.
Le caractère essentiel, le trait distinctif de cette partie de la première rédaction qui s'arrête entre 1369 et 1373 et qui a été composée à la requête et sous les auspices de Robert de Namur, c'est que l'influence anglaise y est beaucoup plus marquée que dans les autres rédactions du premier livre et même que dans le reste des Chroniques. Sans doute, Froissart est trop animé de l'esprit chevaleresque pour ne pas rendre hommage à la générosité, à la bravoure, à la grandeur, partout où il les voit briller; il n'en est pas moins vrai qu'à la complaisance avec laquelle il s'étend sur les événements où l'Angleterre a joué le beau rôle, à l'insistance qu'il met à faire ressortir les prouesses des chevaliers du parti anglais, on reconnaît aisément la prédilection de l'auteur pour la patrie adoptive de Philippe de Hainaut. Au sujet des différends, des guerres, des batailles qui, de 1325 à 1372, mirent aux prises la France et l'Angleterre, la rédaction