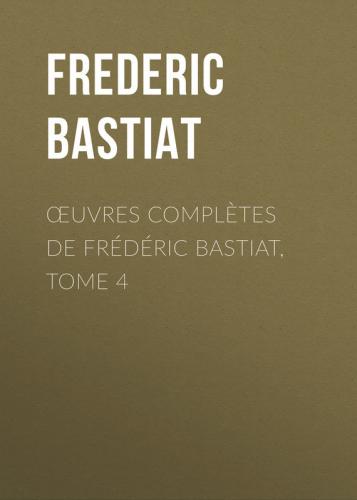J'invoque la patience du lecteur et je le prie de croire que je n'ai pas perdu de vue la liberté commerciale. Qu'il veuille bien seulement se rappeler la conclusion à laquelle je suis arrivé: La rémunération ne se proportionne pas aux UTILITÉS que le producteur porte sur le marché, mais à son travail13.
J'ai pris mes exemples dans les inventions humaines. Parlons maintenant des avantages naturels.
Dans tout produit, la nature et l'homme concourent. Mais la part d'utilité qu'y met la nature est toujours gratuite. Il n'y a que cette portion d'utilité qui est due au travail humain qui fait l'objet de l'échange et par conséquent de la rémunération. Celle-ci varie sans doute beaucoup à raison de l'intensité du travail, de son habileté, de sa promptitude, de son à-propos, du besoin qu'on en a, de l'absence momentanée de rivalité, etc., etc. Mais il n'en est pas moins vrai, en principe, que le concours des lois naturelles appartenant à tous, n'entre pour rien dans le prix du produit.
Nous ne payons pas l'air respirable, quoiqu'il nous soit si utile que, sans lui, nous ne saurions vivre deux minutes. Nous ne le payons pas néanmoins, parce que la nature nous le fournit sans l'intervention d'aucun travail humain. Que si nous voulons séparer un des gaz qui le composent, par exemple, pour faire une expérience, il faut nous donner une peine, ou, si nous la faisons prendre à un autre, il faut lui sacrifier une peine équivalente que nous aurons mise dans un autre produit. Par où l'on voit que l'échange s'opère entre des peines, des efforts, des travaux. Ce n'est véritablement pas le gaz oxygène que je paie, puisqu'il est partout à ma disposition, mais le travail qu'il a fallu accomplir pour le dégager, travail qui m'a été épargné et qu'il faut bien que je restitue. Dira-t-on qu'il y a autre chose à payer, des dépenses, des matériaux, des appareils? mais encore, dans ces choses, c'est du travail que je paie. Le prix de la houille employée représente le travail qu'il a fallu faire pour l'extraire et la transporter.
Nous ne payons pas la lumière du soleil, parce que la nature nous la prodigue. Mais nous payons celle du gaz, du suif, de l'huile, de la cire, parce qu'il y a ici un travail humain à rémunérer; et remarquez que c'est si bien au travail et non à l'utilité que la rémunération se proportionne, qu'il peut fort bien arriver qu'un de ces éclairages, quoique beaucoup plus intense qu'un autre, coûte cependant moins cher. Il suffit pour cela que la même quantité de travail humain en fournisse davantage.
Quand le porteur d'eau vient approvisionner ma maison, si je le payais à raison de l'utilité absolue de l'eau, ma fortune n'y suffirait pas. Mais je le paie à raison de la peine qu'il a prise. S'il exigeait davantage, d'autres la prendraient, et, en définitive, au besoin, je la prendrais moi-même. L'eau n'est vraiment pas la matière de notre marché, mais bien le travail fait à l'occasion de l'eau. Ce point de vue est si important et les conséquences que j'en vais tirer si lumineuses, quant à la liberté des échanges internationaux, que je crois devoir élucider encore ma pensée par d'autres exemples.
La quantité de substance alimentaire contenue dans les pommes de terre ne nous coûte pas fort cher, parce qu'on en obtient beaucoup avec peu de travail. Nous payons davantage le froment, parce que, pour le produire, la nature exige une plus grande somme de travail humain. Il est évident que, si la nature faisait pour celui-ci ce qu'elle fait pour celles-là, les prix tendraient à se niveler. Il n'est pas possible que le producteur de froment gagne d'une manière permanente beaucoup plus que le producteur de pommes de terre. La loi de la concurrence s'y oppose.
Si, par un heureux miracle, la fertilité de toutes les terres arables venait à s'accroître, ce n'est point l'agriculteur, mais le consommateur qui recueillerait l'avantage de ce phénomène, car il se résoudrait en abondance, en bon marché. Il y aurait moins de travail incorporé dans chaque hectolitre de blé, et l'agriculteur ne pourrait l'échanger que contre un moindre travail incorporé dans tout autre produit. Si, au contraire, la fécondité du sol venait tout à coup à diminuer, la part de la nature dans la production serait moindre, celle du travail plus grande, et le produit plus cher. J'ai donc eu raison de dire que c'est dans la consommation, dans l'humanité que viennent se résoudre, à la longue, tous les phénomènes économiques. Tant qu'on n'a pas suivi leurs effets jusque-là, tant qu'on s'arrête aux effets immédiats, à ceux qui affectent un homme ou une classe d'hommes, en tant que producteurs, on n'est pas économiste; pas plus que celui-là n'est médecin qui, au lieu de suivre dans tout l'organisme les effets d'un breuvage, se bornerait à observer, pour le juger, comment il affecte le palais ou le gosier.
Les régions tropicales sont très-favorisées pour la production du sucre, du café. Cela veut dire que la nature fait la plus grande partie de la besogne et laisse peu à faire au travail. Mais alors qui recueille les avantages de cette libéralité de la nature? Ce ne sont point ces régions, car la concurrence les amène à ne recevoir que la rémunération du travail; mais c'est l'humanité, car le résultat de cette libéralité s'appelle bon marché, et le bon marché appartient à tout le monde.
Voici une zone tempérée où la houille, le minerai de fer, sont à la surface du sol, il ne faut que se baisser pour en prendre. D'abord, les habitants profiteront de cette heureuse circonstance, je le veux bien. Mais bientôt, la concurrence s'en mêlant, le prix de la houille et du fer baissera jusqu'à ce que le don de la nature soit gratuitement acquis à tous, et que le travail humain soit seul rémunéré, selon le taux général des profits.
Ainsi les libéralités de la nature, comme les perfectionnements acquis dans les procédés de la production, sont ou tendent sans cesse à devenir, sous la loi de la concurrence, le patrimoine commun et gratuit des consommateurs, des masses, de l'humanité. Donc, les pays qui ne possèdent pas ces avantages ont tout à gagner à échanger avec ceux qui les possèdent, parce que l'échange s'accomplit entre travaux, abstraction faite des utilités naturelles que ces travaux renferment; et ce sont évidemment les pays les plus favorisés qui ont incorporé dans un travail donné le plus de ces utilités naturelles. Leurs produits, représentant moins de travail, sont moins rétribués; en d'autres termes, ils sont à meilleur marché, et si toute la libéralité de la nature se résout en bon marché, évidemment ce n'est pas le pays producteur, mais le pays consommateur, qui en recueille le bienfait.
Par où l'on voit l'énorme absurdité de ce pays consommateur, s'il repousse le produit précisément parce qu'il est à bon marché; c'est comme s'il disait: «Je ne veux rien de ce que la nature donne. Vous me demandez un effort égal à deux pour me donner un produit que je ne puis créer qu'avec une peine égale à quatre; vous pouvez le faire, parce que chez vous la nature a fait la moitié de l'œuvre. Eh bien! moi je le repousse, et j'attendrai que votre climat, devenu plus inclément, vous force à me demander une peine égale à quatre, afin de traiter avec vous sur le pied de l'égalité.»
A est un pays favorisé, B est un pays maltraité de la nature. Je dis que l'échange est avantageux à tous deux, mais surtout à B, parce que l'échange ne consiste pas en utilités contre utilités, mais en valeur contre valeur. Or, A met plus d'utilités sous la même valeur, puisque l'utilité du produit embrasse ce qu'y a mis la nature et ce qu'y a mis