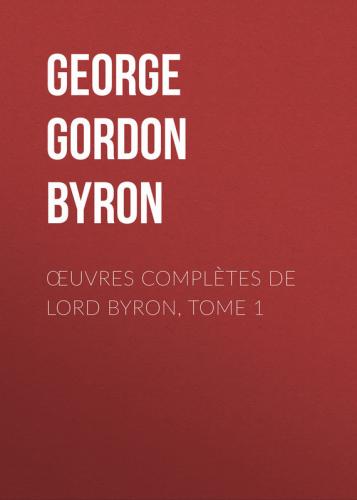Bien que formé sous de funestes auspices, il eût peut-être été fortuné sans l'intervention, presque toujours fâcheuse, d'une belle-mère. Les Milbank conservaient dans leur famille la tradition du vieil esprit d'austérité et d'intolérance qui distinguait les puritains; aussi l'honorable miss Milbank avait-elle consenti avec répugnance à l'union de sa fille avec Byron. Elle ne tarda pas à devenir une mortelle ennemie: la lune de miel même ne fut pas exempte d'orage. Byron eût voulu en passer le cours loin du tumulte de Londres; il craignait les folles dépenses, et surtout les insipides distractions du grand monde: il fut obligé de renoncer à son projet. Partout recherchés avec empressement, recevant à leur tour avec grandeur, la dot de la nouvelle lady fut bientôt dissipée en prodigalités, et Byron prévit de nouveaux embarras pécuniaires. D'un autre côté, son amour de l'étude et des méditations solitaires s'accommodait mal de visites fréquentes et de la présence continuelle d'une épouse soupçonneuse; parfois il accueillait avec fatigue les tendres expansions de lady Byron, et cette femme altière, se croyant alors dédaignée, revenait prêter une crédule oreille aux suggestions de sa mère et d'une ancienne nourrice. Ce n'était pas tout: plusieurs espions féminins venaient nourrir les défiances de ces trois femmes et suivaient sans relâche toutes les démarches de Lord Byron. Dans un secrétaire que lady Byron fit enfoncer, on avait trouvé des lettres amoureuses: par malheur, le nom de l'ancienne maîtresse n'y était pas tracé; il fallut recourir aux conjectures. Une actrice de Drury-Lane (mistress Mardyne) est soupçonnée: sur-le-champ elle est reconnue pour l'indigne cause des froideurs conjugales de Byron. Des pieux salons de la famille Milbank, la nouvelle se fut bientôt répandue dans tous ceux de la capitale, et (voyez la retenue de la haute société anglaise!) quand la pauvre Mardyne reparut sur le théâtre, les dames se couvrirent modestement de leurs éventails ou de leurs mouchoirs; les jeunes dandys sifflèrent, et l'actrice fut obligée de se retirer, en protestant de son innocence. Il fut prouvé, plus tard, qu'elle n'avait jamais dit un seul mot, ni même vu une seule fois Lord Byron.
Lady Byron avait un caractère fort excentrique. Elle s'imagina un autre jour que la froideur de son mari pour ses charmes et surtout pour ses conseils dénotait un certain dérangement de sensorium commune. Par ses ordres, plusieurs inconnus pénétrèrent dans le cabinet d'étude de Byron (il composait alors le Siége de Corinthe); on l'accabla de questions inintelligibles pour lui, et auxquelles sa fierté lui permit à peine de faire quelques réponses. Plus tard, il apprit qu'il avait reçu la visite de docteurs en médecine, chargés d'examiner ses droits au séjour de Bedlam. Il est inutile de dire que ces docteurs ne répondirent pas à l'attente de lady Byron.
Il semblait que la naissance d'une fille, arrivée le 10 décembre 1815, dût mettre un terme à la soucieuse mésintelligence des deux époux; mais, dans le même tems, de nombreux créanciers ayant demandé la garantie de leurs créances, Byron se vit forcé de vendre les somptueuses propriétés qu'il avait, en se mariant, achetées à Londres, à la sollicitation de lady Byron. Les poursuites judiciaires cessèrent: mais, sous prétexte de les prévenir, ils se décidèrent, d'assez bonne grâce, à vivre, pendant deux ou trois mois, éloignés l'un de l'autre. Lady Byron retourna donc chez son père; et quelques jours après, à l'instigation de sa famille, elle écrivit à Lord Byron que jamais elle ne consentirait à le revoir.
Tel est le récit exact de cette séparation, qui a fourni matière à tant d'invectives et de calomnies contre la conduite de notre grand poète. Si le public devint le confident de ses ennuis domestiques, il faut en accuser les indiscrétions ridicules de lady Byron. Écoutons Byron lui-même:
«Il existe dans le mariage une foule de causes inappréciables de dégoûts mutuels et de griefs, dont nos plus intimes amis, ou nos plus proches parens, ne sauraient estimer la juste valeur. Les époux seuls peuvent s'en former une véritable idée; eux seuls ont le droit d'en parler. Tant que le mari n'a pas de torts scandaleux à l'égard de sa femme; tant qu'il ne commet aucune action préjudiciable à la communauté, de quel droit vient-on le blâmer, s'il juge à propos de vivre éloigné d'une femme qu'il connaît mieux, sans doute, que ceux qui prennent sa défense? N'est-il pas absurde de vouloir contraindre deux individus qui se détestent à rester unis, quand ils soupirent tous deux après l'instant de leur séparation? Telle est du moins l'intention de ceux qui, se targuant d'une ancienne liaison, interviennent dans les débats domestiques.»
Quoi qu'il en soit, la séparation de Lord et de lady Byron fit revivre tous les anciens contes dont les précieuses de Londres (les bas bleus) avaient les premières répandu le bruit: tous les écrits périodiques, à l'exception d'un seul (l'Examinateur), les répétèrent à l'envi: une mistress Lee composa un roman dont le héros (Lord Byron) était, sous le nom de Glenarvon, accusé de plusieurs assassinats. On alla jusqu'à imprimer qu'étranger à tous les sentimens de bienveillance et d'humanité il n'était pas même susceptible d'être captivé par les attraits ou les vertus d'une femme; et les stances ravissantes qu'il avait adressées à Thirza, à Maria, à Janthé, ne lui avaient été inspirées que par son attachement pour un ours et le chien de Terre-Neuve dont il avait composé l'épitaphe. Il ne paraissait plus à Drury-Lane sans être accueilli par des huées; les dames le désignaient du doigt, les enfans poursuivaient sa voiture quand il se rendait à la chambre des pairs, et sa vertueuse femme écoutait avec une merveilleuse sérénité le récit des calomnies dont il était abreuvé.
Cependant, cet homme était Lord Byron, le chantre de Childe Harold et du Giaour! celui qui avait défendu de toutes ses forces les catholiques d'Irlande et les chrétiens de l'Orient! Ah! si, pour l'honneur de la France, un aussi puissant génie, une aussi grande ame, eût reçu le jour dans son sein, lui eût-on décerné les mêmes récompenses? Les clameurs de misérables et ridicules coteries auraient-elles ainsi aveuglé l'opinion publique? Nous avons l'orgueil d'en douter.
Il ne faut pas s'étonner si, depuis ce moment, Byron conserva contre l'Angleterre une haine profonde: elle n'était plus digne de ses hommages. Pour comble de disgrâces, il se vit obligé de vendre l'abbaye de Newstead, demeure de ses ancêtres, afin de restituer aux Milbank la dot de lady Byron. Newstead seule le retenait en Angleterre; quand il s'en fut dépouillé, il s'éloigna une seconde fois d'une ingrate patrie, avec la résolution de n'y jamais revenir.
Quelques jours avant son départ, une jeune dame, que ses talens n'avaient pu tirer de la misère, se présente chez lui, et le prie d'honorer de sa protection un recueil de vers qui formait son unique ressource. Elle était belle, ses parens étaient éloignés, et ceux qui d'abord l'avaient encouragée à se dévouer au culte des muses lui avaient retiré leur protection, avant d'avoir pu apprécier si réellement elle en était digne. Byron l'écouta avec attention. Quand elle eut fini de parler: «Puissiez-vous, madame, répondit-il en lui présentant un billet plié, être plus heureuse que moi; puissent vos talens, vos vertus et votre beauté désarmer l'envie! Voici ma souscription. Mais tous deux nous sommes jeunes, et le monde est pervers; je ne veux donc pas avoir l'air de m'intéresser à vos succès: ce serait vous faire plus de tort que de bien.» La jeune dame prit alors congé de lui, et sa surprise fut grande, en rentrant chez elle, de voir que le poète lui avait remis un bon de cinquante louis sur son banquier. Avant qu'elle songeât à publier ce trait de générosité, Byron touchait au rivage de la France.
C'était au printems de 1816. Il emmenait avec lui une bibliothèque composée de poètes grecs, latins et italiens; l'assortiment d'animaux dont nous avons déjà parlé, et le bon et fidèle Fletcher, dont la destinée, assez conforme à celle de son maître, était d'abandonner, de maudire et de regretter sans cesse sa patrie, sa femme et ses enfans. Lord Byron traversa rapidement la France: sa première halte fut le champ de Waterloo. Il parcourut plusieurs fois cette plaine désormais célèbre, et qui lui rendait les impressions de Salamine et de Marathon. Après avoir visité successivement Bruxelles, Coblentz et Bâle, il s'arrêta, pendant l'été, à la campagne Diodati, sur les bords du lac de Genève.
Depuis