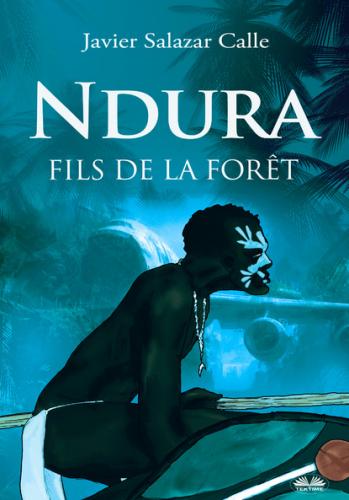Je m’enlevai les baskets et les tordis un peu afin d’en essorer l’eau puis les accrochai à l’extrémité d’une branche pour les faire sécher. Je pris ensuite la bouteille d’eau et cherchai un endroit avec du courant pour la remplir, il me semblait avoir lu qu’il valait mieux ne pas en prendre là où l’eau était stagnante car il y avait davantage de possibilités qu’elle soit insalubre ou qu’elle contienne des bestioles. J’aurais pu m’en rappeler avant de boire. L’ensemble du corps me piquait sans arrêt, mais moins qu’avant. Je sentais des piqûres dans la cuisse et, lorsque je regardai pour voir si j’étais blessé, je vis une sangsue qui s’était collée à ma jambe pour sucer mon sang. C’était une espèce de limace, peut-être plus mince. Je pris d’abord peur mais ensuite je réagis et pensai à comment solutionner cela. Si mes souvenirs étaient bons, on enlevait les sangsues avec du sel ou en les brûlant. Je sortis le briquet et plaçai la flamme tout contre jusqu’à ce qu’elle se recroqueville, j’en profitai pour la décoller avec le couteau. Il ne restait qu’une tache rouge à l’endroit où elle avait été, une goutte de sang coulait sur le bord. Je passai la flamme sur la pointe du couteau et cautérisai la plaie avec précaution. Je ne savais pas du tout si les sangsues infectaient la plaie qu’elles faisaient ou pas et préférais ne pas prendre de risque. La douleur fut tellement grande que je dus faire de gros efforts pour ne pas crier de toutes mes forces. Je passai en revue le reste du corps au cas où il y en aurait eu une autre mais c’était la seule. J’avais maintenant la pointe de mon couteau marquée au feu sur la cuisse. J’allais avoir une cloque énorme. Je n’aurais peut-être pas dû faire cette bêtise.
La paresse prit le contrôle de mon corps et je décidai de ne rien faire de la matinée. Autant d’émotions à la suite m’avaient fatigué, j’étais éreinté et j’avais l’impression que mon corps pesait des tonnes. Je cherchai un endroit ombragé et, une fois sec, je m’habillai. J’utilisai le t-shirt souvenir de Namibie qui était dans mon sac pour protéger ma tête, visage inclus, des nombreux insectes agaçants qui jalonnaient la rive. J’observai un arbuste proche de moi avant de m’allonger. J’en avais déjà vu plusieurs comme ça, au fruit couleur carmin, plutôt voyant, avec de petits pépins bleus13. Serait-ce comestible? J’écrasai une fourmi esseulée que je n’avais pas encore réussi à enlever de sur les habits. Je fermai les yeux et entrai sans résister dans un état de somnolence, d’assoupissement. La chaleur et l’humidité produisaient une lourdeur qui retombait sur les muscles et sur la volonté.
Un coup de feu, puis une rafale d’arme automatique, d’autres coups de feu. Je me levai d’un bond. Ils provenaient des berges du fleuve, bien qu’éloignés. Là ce n’était pas le fruit de mon imagination, ils allaient me trouver d’un instant à l’autre. Je repris conscience d’un coup que ma situation ne me permettait pas de me reposer, que si je ne maintenais pas mes sens constamment en alerte je courais à ma perte certaine.
Je rangeai tout rapidement, mis le t-shirt dans le sac, enfilai mes chaussettes et mes chaussures et je pris mon bâton. Elles étaient encore mouillées, mais à ce moment-là je n’avais pas le temps de faire attention à ces détails. Je décidai que le meilleur chemin possible pour arriver quelque part était de continuer par le lit du fleuve, mais longer la rive me paraissait trop dangereux et je m’enfonçai donc dans la forêt une fois de plus pour essayer de passer inaperçu entre le feuillage et marcher quatre ou cinq mètres en parallèle du fleuve. C’était un monde clos. Où que se posent mes yeux, je ne trouvais qu’un impénétrable mur de verdure sans issue. Je ne voyais tout au plus qu’à 3 ou 4 mètres devant moi. Je perdis bientôt le cours du fleuve et, une fois de plus, me retrouvai en route pour nulle part.
Je marchai en alternant rythme soutenu et rythme plus lent l’après-midi durant, faisant de courtes pauses. Le juste et nécessaire pour reprendre mon souffle et écouter si des coups de feu étaient tirés. A chacun de mes pas, je devais supporter en permanence le bruit de mes souliers, semblable à celui que l’on produit lorsqu’on marche dans une flaque d’eau, ainsi que de sporadiques signaux de crampes dans le mollet. La densité du feuillage augmentait par moments, plongeant certains endroits dans l’ombre. Il y avait des moustiques partout qui n’arrêtaient pas de me harceler comme s’il s’agissait d’une bataille sans fin. Ils me rappelaient parfois les kamikazes japonais de la Seconde Guerre Mondiale, fonçant en piqué sur leur objectif sans se soucier de leurs vies. Les moustiques leur ressemblaient en cela, se ruant sur mon corps en continu sans se soucier des pertes causées par les coups de mains, que j’utilisais comme artillerie anti–aérienne. Certains étaient tellement gros qu’ils ressemblaient davantage à de gigantesques bombardiers qu’à des avions de chasse. Leur seule présence était redoutée des ennemis. J’étais tendu dès que je les apercevais, prêt à les esquiver. Il y en avait toujours un qui avait faim et mes bras et mes jambes n’étaient que piqûres, là où les habits ne me couvraient plus. Certaines piqûres avaient même été faites par-dessus celles des fourmis au réveil. C’était une bataille perdue d’avance, une lutte banale, futile, inutile, car ils n’arrêteraient pas et que j’étais de plus en plus fatigué. Ils m’importunaient tellement que je décidai de recouvrir de terre humide les parties où je n’avais pas d’habits, formant ainsi une barrière impénétrable. Cette idée lumineuse me sauva. Ce n’était pas pratique à l’heure de faire des mouvements, surtout quand ça séchait, mais les attaques continuelles de moustiques étaient pires. Grâce à cette astuce je pus oublier les implacables insectes pendant un bon moment et, bien que je n’obtienne pas la victoire, j’eus au moins droit à une trêve temporaire. De plus, à ma grande surprise, cela eut pour effet de soulager les piqûres de fourmis. Un peu de chance, enfin.
J’observai tout autour de moi, j’avais la constante sensation d’être suivi, d’être à chaque fois un peu plus encerclé, traqué dans une jungle sans fin. J’avais même l’impression d’entendre des pas et des voix derrière moi ou de voir de fugaces visages de guérilleros me regardant d’un air féroce entre les arbres, surveillant sans cesse. A vrai dire, je n’en vis aucun clairement, je ne pus même pas trouver une trace de leur présence dans la zone. J’avais l’impression que les arbres ployaient au-dessus de ma tête, m’emprisonnant toujours plus dans une cellule de bois vivante. Je ne savais pas si je devenais paranoïaque ou quoi, mais je devais arriver à me calmer pour pouvoir survivre dans cette jungle inconnue et mortelle.
Je tombai sur un tableau dantesque au cours de cette démente déambulation. Ce qui semblait être les membres d’une famille de primates, de la taille d’un chimpanzé ou d’une espèce semblable, gisaient dans une clairière, au milieu de grandes flaques de sang séché et entourés par des myriades de mouches et par toute sorte d’insectes et de charognards. Ils étaient dépourvus de mains, de pieds et de têtes. La puanteur qui s’en échappait était insupportable et je ne pus réprimer l’envie de vomir qui me monta instantanément à la gorge. Je rassemblai tout mon courage et regardai à nouveau. Il devait y avoir deux adultes et un plus jeune. Il ne semblait pas y avoir de petit, je ne savais pas si c’était parce qu’on l’avait capturé, parce qu’il