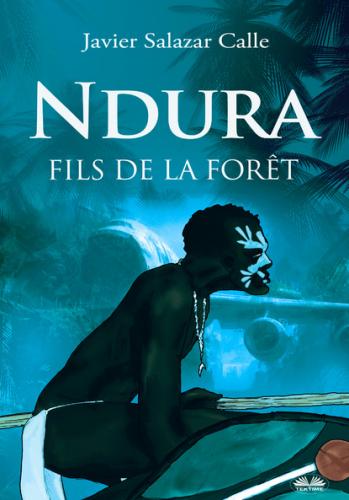Pendant ma marche, je rencontrai des oiseaux colorés, au poitrail rouge vif et avec le reste du corps vert6. Douze ou quinze oiseaux voletaient entre les branches des arbres avec une agilité incroyable. Lorsque je fis un peu de bruit, ils disparurent de ma vue en un claquement de doigts. Seuls ces beaux animaux me tirèrent, pour un moment, de l’écrasante sensation de solitude avec laquelle la forêt me frappait implacablement. Un monde oppressant, hostile, sans compassion, plongé dans une pénombre permanente, dans lequel l’angoisse, l’abattement ou la sensation d’étouffement étaient de constants compagnons de route.
Le chemin était difficile, je devais constamment faire des détours ou sauter des obstacles. Il y avait, de temps à autres, de petites clairières, mais je les longeais par peur d’être trop visible. Je transpirais sans arrêt et j’avais très soif, mais je ne voulais pas boire une autre canette puisqu’il ne m’en restait que trois. Il devait faire 25º, avec un taux d’humidité très haut, ce qui accentuait la sensation d’oppression et de chaleur. J’ôtai ma chemise un moment, mais je fus piqué par tant de moustiques que je dus la remettre. A des moments, le bocage était tellement épais que je devais me frayer un chemin avec un bâton que j’utilisais en guise de machette. Dans ces cas là, je n’avançais pratiquement pas: je n’arrivais qu’à écarter les branches sur mon passage, pas à les couper. De plus, la partie inférieure de mes jambes et de mes avant-bras, à l’endroit où les habits ne me couvraient pas, était couverte de blessures de plantes. Plusieurs parties de mon visage piquaient également. Cela signalait que j’y avais aussi des coupures.
Parfois, le sol était jonché de branches ou de troncs déracinés, d’autres fois, le sol était meuble, recouvert de feuilles mortes. Je devais marcher prudemment pour ne pas me tordre une cheville en posant le pied dans quelque trou ou en glissant, cela me serait fatal. Dans certaines zones, les cimes des arbres étaient tellement rapprochées qu’elles ne laissaient pas passer la lumière, créant ainsi une atmosphère de clair-obscur vraiment lugubre. Ou bien elles formaient plusieurs planchers de lumière aux nuances différentes suivant le niveau. Je traversais ces parties avec crainte car j’avais l’impression de me voir constamment attaqué par des fantômes. Ce n’était, en réalité, que les plus hautes branches des arbres se balançant au vent, qui devait souffler sur le toit vert de la forêt et qui, au passage, leur faisait produire un constant hurlement, vous glaçant le sang et vous harcelant sans cesse. Souvent, la forêt était tellement dense qu’elle était absolument impraticable et je devais faire de grands détours pour continuer à avancer. Je n’aurais jamais cru qu’il puisse y avoir autant de plantes différentes en un même endroit. Je ne voyais plus l’aspect romantique de marcher dans la jungle comme les explorateurs, je dirai même plus, je souhaitais sortir le plus tôt possible de ce lieu. De plus, comme je faisais généralement beaucoup de bruit, mon cœur se serrait à l’idée qu’il serait très facile de me localiser si j’étais suivi.
De la même manière qu’un bruit incessant provenait de partout pendant la nuit, un bruit différent se faisait entendre pendant le jour: des bourdonnements d’insectes, des chants étranges d’oiseaux dans la cime des arbres et quelques cris que j’attribuai à des singes ou à quelque chose comme ça. Du moins l’on n’entendait pas de rugissements inquiétants. Ils devaient avoir été produits par quelque chasseur nocturne. C’est ce que je voulais croire. Je ne voyais pas beaucoup d’animaux, mais je pouvais sentir leur présence.
Je regardai l’heure à ma montre. Il était dix heures du matin. Je marchais depuis une heure et n’en pouvais plus. Le genou avait déjà commencé à envoyer des signaux d’avertissement et je remarquai qu’il était légèrement enflammé. Les ligaments, ou je ne sais quoi, s’étaient déplacés à plusieurs reprises et j’avais dû les remettre en place avec la main, en massant doucement mais fermement. Je m’assis par terre pour me reposer un peu, le dos appuyé à un très grand arbre et me passai la main sur le genou. La chaleur me soulagea légèrement. Je me trouvais dans une zone assez à découvert. Assis depuis un bon moment, je vis un oiseau semblable à un perroquet, posé sur la branche d’un arbre en face de moi. Son plumage était bleu pâle avec, comme unique touche de couleur, le rouge de sa queue. Il avait une auréole blanche autour des yeux, le bec noir et il émettait des cris presque humains7. Il tournait la tête dans pratiquement toutes les directions sans bouger le reste du corps, me rappelant l’enfant dans l’Exorciste. Il s’approcha d’un fruit de l’arbre en se balançant et commença à le picorer. Le fruit était de couleur rouge-orangé, de la taille d’une main et de forme semblable à une courge.
– Toi tu sais surement où tu es – dis-je en moi-même – c’est sûr.
Je me reposai environ une demi-heure puis me remis en route. A chaque fois que je longeais une clairière et devais reprendre la bonne direction, j’étais d’avantage convaincu du fait que je pourrais tourner en rond pendant des années sans m’en rendre compte. Pour moi, tout se ressemblait et le soleil ne m’était plus d’une grande utilité. Je regardais à quelle hauteur il se trouvait, vérifiait avec l’heure à la montre et arrivais à la conclusion de n’avoir aucune idée de ce que je faisais. Je suivis le même rythme toute la matinée : je marchais pendant une heure et me reposais. Pendant les pauses, je lisais le livre de phrases en swahili ou celui sur les voyages pour occuper l’esprit avec quelque chose, peut-être cela me servirait-il à communiquer avec quelqu’un lors d’une hypothétique rencontre. J’avais à chaque fois plus de mal à me lever pour continuer, le genou me faisait boiter et, vers deux heures de l’après-midi, je jetai l’éponge.
Tout était ma faute, j’avais traîné mes amis dans ce lieu infernal, ils étaient morts à cause de moi. Si je les avais écouté, à l’heure actuelle nous serions de retour d’Italie avec un tas de photos de Venise et une carte postale de la Toscane. Ma faute, tout était ma faute.
J’avais soif et mon estomac grondait sans arrêt. De deux choses l’une: je mangeais comme il faut pour récupérer des forces ou j’économisais le peu de nourriture dont je disposais, risquant ainsi qu’il m’arrive quelque chose. Trouver de la nourriture et de l’eau dans la jungle aurait dû être simple, c’est du moins ce que je croyais à ce moment-là. J’avais très faim et décidai donc de boire une canette de rafraîchissement et de manger le sandwich et les biscuits déjà croqués, écartant les fourmis en leur soufflant dessus. Je calmai un peu ma faim tenace. Je gardai la pâte de coings pour plus tard, pensant qu’elle mettrait plus de temps à se gâter. Ensuite je m’endormis: j’étais fatigué et n’avais pas pu dormir la nuit d’avant.
Lorsque je m’éveillai, j’entendis un sifflement très proche de moi. Je devais avoir un serpent à côté. Je restai parfaitement immobile, tendant l’oreille pour essayer de savoir où il pouvait être. La peur me prit à l’estomac et je commençai à respirer difficilement. Une fois, j’avais vu un reportage sur des serpents appelés les “serpents des trois pas”, parce qu’après t’avoir mordu on n’avait le temps que de faire trois pas avant de tomber raide mort. Dans le fond ce n’était pas mal vu la situation. En revanche, si je devais passer des heures à agoniser après avoir été mordu, perdant peu à peu le contrôle, atteignant le paroxysme de la douleur… j’avais tellement peur de souffrir, tellement peur de la douleur. Si je devais mourir, autant que ce soit rapide, je le souhaitais presque pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle je me trouvais. Je le méritais. Le sifflement semblait se rapprocher chaque fois davantage, je pouvais même entendre le craquement des feuilles sur son passage, il venait vers moi, j’en étais sûr. Je pouvais presque le sentir glisser sur mon corps, montant par ma jambe et se dirigeant vers mon cou, il était presque arrivé, il allait me mordre. Je fermai les yeux un moment et respirai profondément pour essayer de me calmer. Je les rouvris ensuite et, sans bouger d’un centimètre, les remuai dans toutes les directions pour essayer de le localiser. Je le vis, enfin. Il était tranquillement enroulé à la branche d’un arbre, trois mètres à ma droite, à peu près