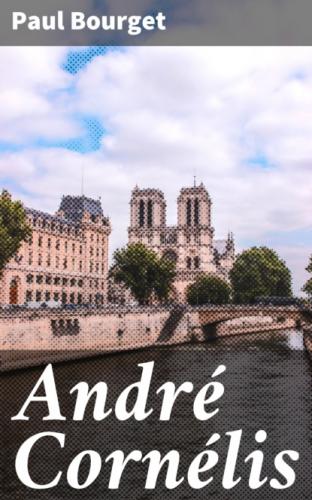La justice, qui n'a pas de ces pudeurs sentimentales, eut-elle ce soupçon comme moi, ou d'autres encore? S'il en fut ainsi, l'imagination de ses représentants se heurta au point indiscutable et inexplicable, à la réalité de ce Rochdale, dont l'existence ne pouvait pas être contestée, non plus que sa présence à l'hôtel Impérial depuis les sept heures du soir la veille jusqu'à deux heures de l'après-midi le lendemain; et puis il s'était évanoui, comme un être fantastique, sans qu'une seule trace en demeurât,—une seule. Cet homme était venu, d'autres hommes lui avaient parlé. On savait où il avait passé la nuit et la matinée d'avant le crime. Il avait accompli son œuvre de meurtre, et puis rien. Tout Paris se passionna pour cette affaire, et depuis, lorsque j'ai voulu rechercher la collection des journaux relatifs à elle, j'ai trouvé que, pendant plus de six semaines, les chroniqueurs en avaient parlé chaque matin. Ensuite la rubrique fatale avait disparu des colonnes des journaux, comme le souvenir de cette lugubre énigme s'était effacé de la mémoire des lecteurs, comme le souci de cette enquête de la pensée des limiers de police. La vie avait continué, roulant cette épave dans sa vague qui emporte toutes choses. Oui; mais moi, le fils? Comment oublier jamais le récit de la vieille femme, qui avait rempli d'une tragique épouvante ma petite chambre d'enfant? Comment ne pas revoir toujours et toujours la face pâle de l'assassiné, ses yeux ouverts, sa bouche fermée par une mentonnière, le linge noué de son front? Comment ne pas dire: je te vengerai, pauvre mort.—Pauvre mort!...—Lorsque je lus l'Hamlet de Shakespeare pour la première fois, avec cette avidité passionnante que donne à l'esprit une analogie entre la situation morale étudiée dans une œuvre d'art et quelque crise de notre propre vie, je me souviens que ce jeune homme me fit horreur. Ah! si le fantôme de mon père était venu me raconter, à moi, avec ses lèvres sans souffle, le drame qui l'avait tué, aurais-je hésité une minute? Non! m'écriais-je; et puis j'ai tout su, et puis j'ai hésité, comme lui, moins que lui pourtant, à oser l'action terrible.—Silence! Silence!... Revenons encore aux faits.
IV
Oui, la vie avait repris son cours presque normal quand le second mariage de ma mère me fut annoncé. Je me souviens, cette fois, avec une précision minutieuse, non seulement de l'époque, mais du jour et de l'heure. Je me trouvais en vacances chez mon unique tante, une sœur de mon père, vieille demoiselle de quarante-cinq ans, qui habitait Compiègne. Elle vivait là, dans une maison située à l'extrémité de la ville, avec trois domestiques, parmi lesquels était ma bonne Julie, dont le caractère ne convenait pas à maman. Ma tante Louise était petite, avec un air d'une personne de province;—à peine si elle consentait à visiter Paris pour quarante-huit heures, quand vivait mon père. Elle portait presque toujours une robe de soie noire faite à la maison, avec une ligne de blanc au cou et aux poignets, et autour du cou aussi une vieille chaîne d'or, très longue, qui passait sous son corsage et ressortait à sa ceinture avec sa montre et des breloques anciennes. Quand elle n'avait pas son bonnet à rubans, noirs comme sa robe, ses cheveux grisonnants montraient leurs bandeaux et encadraient un front et des yeux d'une telle expression de douceur, que la pauvre femme plaisait tout de suite, malgré son nez un peu fort, ses lèvres trop larges et son menton trop long. Elle avait élevé mon père ici même, dans cette petite ville de Compiègne. Elle lui avait donné de sa fortune ce qu'elle avait pu distraire des besoins si simples de sa vie. Quand il avait voulu épouser Mlle de Slane, c'était le nom de jeune fille de maman, elle l'avait doté pour que la famille où il voulait entrer s'ouvrît plus aisément devant lui. Combien elle avait souffert depuis deux ans, le contraste entre le portrait que j'avais d'elle dans mon album d'enfant et de son visage actuel le disait assez. Ses cheveux avaient beaucoup blanchi, les rides qui vont des narines aux coins des lèvres s'étaient creusées, ses paupières s'étaient comme flétries. Et cependant elle ne s'était livrée à aucune démonstration. À mon regard de petit garçon observateur, l'antithèse entre le caractère de ma mère et celui de ma tante se précisait dans la différence de leurs douleurs. Alors j'avais de la peine à comprendre la réserve de la vieille fille dont je ne pouvais cependant pas suspecter la tendresse. Aujourd'hui, c'est