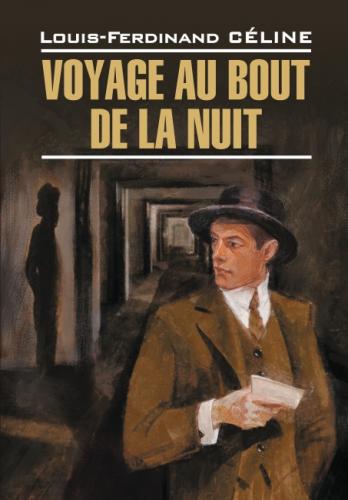Elle apparaissait avec son violon dans une manière de prologue impromptu, versifié, mélodieux. Un genre adorable et compliqué.
Avec ce sentiment que je lui vouai mon temps devint frénétique et se passait en bondissements de l’hôpital à la sortie de son théâtre. Je n’étais d’ailleurs presque jamais seul à l’attendre. Des militaires terrestres la ravissaient à tour de bras, des aviateurs aussi et bien plus facilement encore, mais le pompon séducteur revenait sans conteste aux Argentins. Leur commerce de viandes froides à ceux‐là, prenait grâce à la pullulation des contingents nouveaux, les proportions d’une force de la nature. La petite Musyne en a bien profité de ces jours mercantiles. Elle a bien fait, les Argentins n’existent plus.
Je ne comprenais pas. J’étais cocu avec tout et tout le monde, avec les femmes, l’argent et les idées. Cocu et pas content. À l’heure qu’il est, il m’arrive encore de la rencontrer Musyne, par hasard, tous les deux ans ou presque, ainsi que la plupart des êtres qu’on a connus très bien. C’est le délai qu’il nous faut, deux années, pour nous rendre compte, d’un seul coup d’œil, intrompable alors, comme l’instinct, des laideurs dont un visage, même en son temps délicieux, s’est chargé.
On demeure comme hésitant un instant devant, et puis on finit par l’accepter tel qu’il est devenu le visage avec cette disharmonie croissante, ignoble, de toute la figure. Il le faut bien dire oui, à cette soigneuse et lente caricature burinée par deux ans. Accepter le temps, ce tableau de nous. On peut dire alors qu’on s’est reconnus tout à fait (comme un billet étranger qu’on hésite à prendre à première vue) qu’on ne s’était pas trompés de chemin, qu’on avait bien suivi la vraie route, sans s’être concertés, l’immanquable route pendant deux années de plus, la route de la pourriture. Et voilà tout.
Musyne, quand elle me rencontrait ainsi, fortuitement, tellement je l’épouvantais avec ma grosse tête, semblait vouloir me fuir absolument, m’éviter, se détourner, n’importe quoi… Je lui sentais mauvais, c’était évident, de tout un passé, mais moi qui sais son âge, depuis trop d’années, elle a beau faire, elle ne peut absolument plus m’échapper. Elle reste là l’air gêné devant mon existence, comme devant un monstre. Elle, si délicate, se croit tenue de me poser des questions balourdes, imbéciles, comme en poserait une bonne prise en faute. Les femmes ont des natures de domestiques. Mais elle imagine peut-être seulement cette répulsion, plus qu’elle ne l’éprouve; c’est l’espèce de consolation qui me demeure. Je lui suggère peut-être seulement que je suis immonde. Je suis peut-être un artiste dans ce genre-là. Après tout, pourquoi n’y aurait-il pas autant d’art possible dans la laideur que dans la beauté? C’est un genre à cultiver, voilà tout.
J’ai cru longtemps qu’elle était sotte la petite Musyne, mais ce n’était qu’une opinion de vaniteux éconduit. Vous savez, avant la guerre, on était tous encore bien plus ignorants et plus fats qu’aujourd’hui. On ne savait presque rien des choses du monde en général, enfin des inconscients… Les petits types dans mon genre prenaient encore bien plus facilement qu’aujourd’hui des vessies pour des lanternes. D’être amoureux de Musyne si mignonne je pensais que ça allait me douer de toutes les puissances, et d’abord et surtout du courage qui me manquait, tout ça parce qu’elle était si jolie et si joliment musicienne ma petite amie! L’amour c’est comme l’alcool, plus on est impuissant et soûl et plus on se croit fort et malin, et sûr de ses droits.
Mme Herote, cousine de nombreux héros décédés, ne sortait plus de son impasse qu’en grand deuil; encore, n’allait-elle en ville que rarement, son commissaire ami se montrant assez jaloux. Nous nous réunissions dans la salle à manger de l’arrière-boutique, qui, la prospérité venue, prit bel et bien les allures d’un petit salon. On y venait converser, s’y distraire, gentiment, convenablement sous le gaz. Petite Musyne, au piano, nous ravissait de classiques, rien que des classiques, à cause des convenances de ces temps douloureux. Nous demeurions là, des après-midi, coude à coude, le commissaire au milieu, à bercer ensemble nos secrets, nos craintes, et nos espoirs.
La servante de Mme Herote, récemment engagée, tenait beaucoup à savoir quand les uns allaient se décider enfin à se marier avec les autres. Dans sa campagne on ne concevait pas l’union libre. Tous ces Argentins, ces officiers, ces clients fureteurs lui causaient une inquiétude presque animale.
Musyne se trouvait de plus en plus souvent accaparée par les clients sud‐américains. Je finis de cette façon par connaître à fond toutes les cuisines et domestiques de ces messieurs, à force d’aller attendre mon aimée à l’office. Les valets de chambre de ces messieurs me prenaient d’ailleurs pour le maquereau. Et puis, tout le monde finit par me prendre pour un maquereau, y compris Musyne elle-même, en même temps je crois que tous les habitués de la boutique de Mme Herote. Je n’y pouvais rien. D’ailleurs, il faut bien que cela arrive tôt ou tard, qu’on vous classe.
J’obtins de l’autorité militaire une autre convalescence de deux mois de durée et on parla même de me réformer. Avec Musyne nous décidâmes d’aller loger ensemble à Billancourt. C’était pour me semer en réalité ce subterfuge parce qu’elle profita que nous demeurions loin, pour rentrer de plus en plus rarement à la maison. Toujours elle trouvait de nouveaux prétextes pour rester dans Paris.
Les nuits de Billancourt étaient douces, animées parfois par ces puériles alarmes d’avions et de zeppelins, grâce auxquelles les citadins trouvaient moyen d’éprouver des frissons justificatifs. En attendant mon amante, j’allais me promener, nuit tombée, jusqu’au pont de Grenelle, là où l’ombre monte du fleuve jusqu’au tablier du métro, avec ses lampadaires en chapelets, tendu en plein noir, avec sa ferraille énorme aussi qui va foncer en tonnerre en plein flanc des gros immeubles du quai de Passy.
Il existe certains coins comme ça dans les villes, si stupidement laids qu’on y est presque toujours seul.
Musyne finit par ne plus rentrer à notre espèce de foyer qu’une fois par semaine. Elle accompagnait de plus en plus fréquemment des chanteuses chez les Argentins. Elle aurait pu jouer et gagner sa vie dans les cinémas, où ç’aurait été bien plus facile pour moi d’aller la chercher, mais les Argentins étaient gais et bien payants, tandis que les cinémas étaient tristes et payaient peu. C’est toute la vie ces préférences.
Pour comble de mon infortune survint le Théâtre aux Armées. Elle se créa instantanément, Musyne, cent relations militaires au Ministère et de plus en plus fréquemment elle partit alors distraire au front nos petits soldats et cela durant des semaines entières. Elle y détaillait, aux armées, la sonate et l’adagio devant les parterres d’État-major, bien placés pour lui voir les jambes. Les soldats parqués en gradins à l’arrière des chefs ne jouissaient eux que des échos mélodieux. Elle passait forcément ensuite des nuits très compliquées dans les hôtels de la zone des Armées. Un jour elle m’en revint toute guillerette des Armées et munie d’un brevet d’héroïsme, signé par l’un de nos grands généraux, s’il vous plaît. Ce diplôme fut à l’origine de sa définitive réussite.
Dans la colonie argentine, elle sut se rendre du coup extrêmement populaire. On la fêta. On en raffola de ma Musyne, violoniste de guerre si mignonne! Si fraîche et bouclée et puis héroïne par-dessus le marché. Ces Argentins avaient la reconnaissance du ventre, ils vouaient à nos grands chefs une de ces admirations qui n’était pas dans une musette, et quand elle leur revint ma Musyne, avec son document authentique, sa jolie frimousse, ses petits doigts agiles et glorieux, ils se mirent à l’aimer à qui mieux mieux, aux enchères pour ainsi dire. La poésie héroïque possède sans résistance ceux qui ne vont pas à la guerre et mieux encore ceux que la guerre est en train