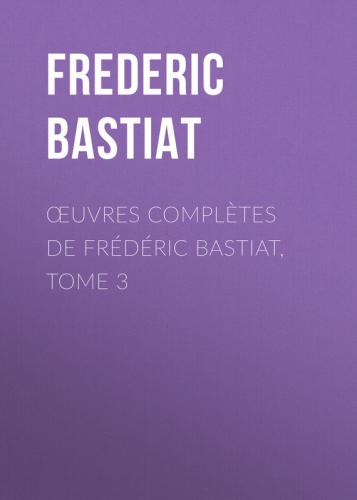«Dans les archipels du grand Océan, les cadets de famille n'ont aucune part dans la succession de leurs pères. Ils ne peuvent donc vivre que des aliments que leur donnent leurs aînés, s'ils restent en famille; ou de ce que peut leur donner la population asservie, s'ils entrent dans l'association militaire des arreoys. Mais, quel que soit celui des deux partis qu'ils prennent, ils ne peuvent espérer de perpétuer leur race. L'impuissance de transmettre à leurs enfants aucune propriété et de les maintenir dans le rang où ils naissent, est sans doute ce qui leur a fait une loi de les étouffer2.»
L'aristocratie anglaise, quoique sous l'influence des mêmes instincts qui inspirent l'aristocratie malaie (car les circonstances varient, mais la nature humaine est partout la même), s'est trouvée, si je puis m'exprimer ainsi, dans un milieu plus favorable. Elle a eu, en face d'elle et au-dessous d'elle, la population la plus laborieuse, la plus active, la plus persévérante, la plus énergique et en même temps la plus docile du globe; elle l'a méthodiquement exploitée.
Rien de plus fortement conçu, de plus énergiquement exécuté que cette exploitation. La possession du sol met aux mains de l'oligarchie anglaise la puissance législative; par la législation, elle ravit systématiquement la richesse à l'industrie. Cette richesse, elle l'emploie à poursuivre au dehors ce système d'empiétements qui a soumis quarante-cinq colonies à la Grande-Bretagne; et les colonies lui servent à leur tour de prétexte pour lever, aux frais de l'industrie et au profit des branches cadettes, de lourds impôts, de grandes armées, une puissante marine militaire.
Il faut rendre justice à l'oligarchie anglaise. Elle a déployé, dans sa double politique de spoliation intérieure et extérieure, une habileté merveilleuse. Deux mots, qui impliquent deux préjugés, lui ont suffi pour y associer les classes mêmes qui en supportent tout le fardeau: elle a donné au monopole le nom de Protection, et aux colonies celui de Débouchés.
Ainsi l'existence de l'oligarchie britannique, ou du moins sa prépondérance législative, n'est pas seulement une plaie pour l'Angleterre, c'est encore un danger permanent pour l'Europe.
Et s'il en est ainsi, comment est-il possible que la France ne prête aucune attention à cette lutte gigantesque que se livrent sous ses yeux l'esprit de la civilisation et l'esprit de la féodalité? Comment est-il possible qu'elle ne sache pas même les noms de ces hommes dignes de toutes les bénédictions de l'humanité, les Cobden, les Bright, les Moore, les Villiers, les Thompson, les Fox, les Wilson et mille autres qui ont osé engager le combat, qui le soutiennent avec un talent, un courage, un dévouement, une énergie admirables? C'est une pure question de liberté commerciale, dit-on. Et ne voit-on pas que la liberté du commerce doit ravir à l'oligarchie et les ressources de la spoliation intérieure, – les monopoles, – et les ressources de la spoliation extérieure, – les colonies, – puisque monopoles et colonies sont tellement incompatibles avec la liberté des échanges, qu'ils ne sont autre chose que la limite arbitraire de cette liberté!
Mais que dis-je? Si la France a quelque vague connaissance de ce combat à mort qui va décider pour longtemps du sort de la liberté humaine, ce n'est pas à son triomphe qu'elle semble accorder sa sympathie. Depuis quelques années, on lui a fait tant de peur des mots liberté, concurrence, sur-production; on lui a tant dit que ces mots impliquent misère, paupérisme, dégradation des classes ouvrières; on lui a tant répété qu'il y avait une économie politique anglaise, qui se faisait de la liberté un instrument de machiavélisme et d'oppression, et une économie politique française qui, sous les noms de philanthropie, socialisme, organisation du travail, allait ramener l'égalité des conditions sur la terre, – qu'elle a pris en horreur la doctrine qui ne se fonde après tout que sur la justice et le sens commun, et qui se résume dans cet axiome: «Que les hommes soient libres d'échanger entre eux, quand cela leur convient, les fruits de leurs travaux. – Si cette croisade contre la liberté n'était soutenue que par les hommes d'imagination, qui veulent formuler la science sans s'être préparés par l'étude, le mal ne serait pas grand. Mais n'est-il pas douloureux de voir de vrais économistes, poussés sans doute par la passion d'une popularité éphémère, céder à ces déclamations affectées et se donner l'air de croire ce qu'assurément ils ne croient pas, à savoir: que le paupérisme, le prolétariat, les souffrances des dernières classes sociales doivent être attribués à ce qu'on nomme concurrence exagérée, sur-production?
Ne serait-ce pas, au premier coup d'œil, une chose bien surprenante que la misère, le dénûment, la privation des produits eussent pour cause… quoi? précisément la surabondance des produits? N'est-il pas singulier qu'on vienne nous dire que si les hommes n'ont pas suffisamment de quoi se nourrir, c'est qu'il y a trop d'aliments dans le monde? que s'ils n'ont pas de quoi se vêtir, c'est que les machines jettent trop de vêtements sur le marché? Assurément le paupérisme en Angleterre est un fait incontestable; l'inégalité des richesses y est frappante. Mais pourquoi aller chercher à ces phénomènes une cause si bizarre, quand ils s'expliquent par une cause si naturelle: la spoliation systématique des travailleurs par les oisifs?
C'est ici le lieu de décrire le régime économique de la Grande-Bretagne, tel qu'il était dans les dernières années qui ont précédé les réformes partielles, et à certains égards trompeuses, dont, depuis 1842, le Parlement est saisi par le cabinet actuel.
La première chose qui frappe dans la législation financière de nos voisins, et qui est faite pour étonner les propriétaires du continent, c'est l'absence presque totale d'impôt foncier, dans un pays grevé d'une si lourde dette et d'une si vaste administration.
En 1841, sous la reine Victoria:
Ainsi l'impôt direct est resté le même pendant que les impôts de consommation ont décuplé.
Et il faut considérer que, dans ce laps de temps, la rente des terres ou le revenu du propriétaire a augmenté dans la proportion de 1 à 7, en sorte que le même domaine qui, sous la reine Anne, acquittait 20 pour 100 de contributions sur le revenu, ne paie pas aujourd'hui 3 pour 100.
On remarquera aussi que l'impôt foncier n'entre que pour un vingt-cinquième dans le revenu public (2 millions sur 50 dont se composent les recettes générales). En France, et dans toute l'Europe continentale, il en constitue la portion la plus considérable, si l'on ajoute à la taxe annuelle les droits perçus à l'occasion des mutations et transmissions, droits dont, de l'autre côté de la Manche, la propriété immobilière est affranchie, quoique la propriété personnelle et industrielle y soit rigoureusement assujettie.
La même partialité se montre dans les taxes indirectes. Comme elles sont uniformes au lieu d'être graduées selon les qualités des objets qu'elles frappent, il s'ensuit qu'elles pèsent incomparablement plus sur les classes pauvres que sur les classes opulentes.
Ainsi le thé Pekoe vaut 4 shillings et le Bohea 9 deniers; le droit étant de 2 shillings, le premier est taxé à raison de 50, et le second à raison de 300 pour 100.
Ainsi