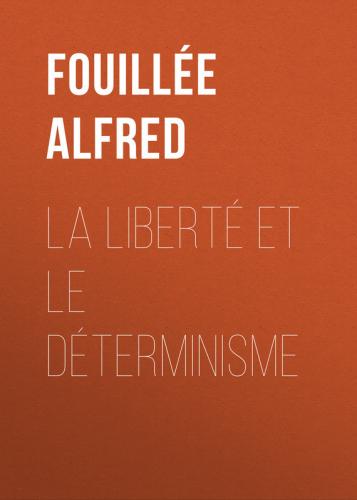A l'objection de Kant, tirée de la communication du mouvement et, en dernière analyse, de la communication du changement ou des manières d'être, on ne pourrait répondre qu'en montrant dans la conscience quelque chose d'absolument incommunicable; et pour trouver ce je ne sais quoi d'incommunicable, il ne suffirait pas de comparer le moi en différents temps, il faudrait pouvoir reconnaître, non seulement dans un seul et même instant, mais même indépendamment de toute durée, ce qui le rend incommunicable et impénétrable. Or, dès qu'on s'élève au-dessus du temps comme de l'espace, l'être est, au contraire, nécessairement pensé comme communicable, pénétrable, ouvert de toutes parts, en un mot universel. L'individuation, à cette hauteur, se perd dans un profond mystère, et on ne peut plus comprendre tous les esprits que dans un seul esprit. D'autre part, si de cette région problématique des noumènes nous redescendons dans le monde du temps et de l'expérience, le moi ne nous offre plus qu'une impénétrabilité de fait et en quelque sorte matérielle, qu'une incommunicabilité relative qui peut n'être pas définitive. En effet, il y a nécessairement communication, d'une manière quelconque, entre les êtres, puisqu'en fait et dans l'expérience nous nous communiquons des changements, des modifications, nous agissons et pâtissons les uns par rapport aux autres. Contre ce fait (pas plus que contre la réalité du mouvement) ne peuvent prévaloir les spéculations des métaphysiciens sur l'incommunicabilité entre les «substances,» ou, si les substances sont réellement incommunicables, le fait de la communication réciproque prouve précisément que nous ne sommes point des substances. L'histoire naturelle et la psychologie des animaux nous montrent la fusion de plusieurs êtres en un seul, doué probablement de quelque conscience centrale. L'insecte coupé en deux tronçons qui continuent de sentir nous révèle la division possible d'une conscience encore à l'état de dispersion. La communication mutuelle des sensations entre les deux sœurs jumelles soudées par le tronc, est un fait physiologique qui nous ouvre des perspectives sur la possibilité de fondre deux cerveaux, deux vies, peut-être deux consciences en une seule28. Actuellement, les moi sont impénétrables; mais l'impossibilité de les fondre peut tenir à l'impossibilité de fondre les cerveaux. Si nous pouvions greffer un centre cérébral sur un autre, rien ne prouve que nous ne ferions pas entrer des sensations, auparavant isolées, dans une conscience commune, comme un son entre dans un accord qui a pour nous son unité, sa forme individuelle. Sans doute, nous n'arrivons pas à comprendre ce mystère: ne faire plus qu'un avec une autre conscience, se fondre en autrui, et pourtant c'est ce que rêve et semble poursuivre l'amour. Qui sait si ce rêve n'est pas l'expression de ce que fait continuellement la nature, et si l'alchimie universelle n'opère pas la transmutation des sensations par la centralisation progressive des organismes? Ce moi dont nous voudrions faire quelque chose d'absolu, – qui pourtant doit bien être dérivé de quelque façon et de quelque façon relatif, s'il n'est pas l'«Absolu» même, s'il n'est pas Dieu, – ce moi que Descartes voulait établir au rang de premier principe, plus nous le cherchons, plus nous le voyons s'évanouir, soit dans les phénomènes dont il semble l'harmonie concrète, soit dans l'être universel qui n'est plus ma pensée, mais la pensée ou l'action partout présente.
Dès lors, que devient la conscience de notre indépendance en tant que moi, de notre liberté individuelle?
Cette conscience de la liberté supposerait que nous nous voyons absolument indépendants: 1o de notre corps; 2o de l'univers; 3o du principe même de l'univers. Eh bien, nous aurons beau contempler notre conscience et répéter avec Descartes: cogito, cogito, nous ne verrons pas par là notre réelle indépendance par rapport à notre organisme. «Ce qui peut être conçu séparément, dit Descartes, peut aussi exister séparément.» Kant a montré l'impossibilité de ce passage d'une distinction intellectuelle, subjective, à une séparation réelle, objective. «Dire que je distingue ma propre existence, comme être pensant, des autres choses qui sont hors de moi, et dont mon corps fait aussi partie, c'est là une proposition simplement analytique; car les autres choses sont précisément celles que je conçois comme distinctes de moi. Mais cette conscience de moi-même est-elle possible sans les choses hors de moi, par lesquelles les représentations me sont données, et par conséquent puis-je exister simplement comme être pensant, sans être homme [et uni à un corps]? C'est ce que je ne sais point du tout par là29.»
Je sais encore bien moins, par la connaissance de ma conscience, si je puis exister indépendamment de la totalité des êtres, de l'univers avec lequel mes organes me mettent en communication. Il faudrait, pour le savoir, que j'eusse mesuré l'action de toutes les causes extérieures, et que je pusse montrer un résidu inexplicable par ces causes, explicable par moi. J'aurais besoin, pour résoudre ce problème, de la science universelle. La prétendue conscience de la liberté serait donc identique à la science de l'univers. Quant à savoir si je puis exister sans un principe supérieur à moi comme à l'univers même, en un mot si je suis l'absolu, c'est ce que l'inspection de ma conscience ne m'apprendra jamais. Et pourtant, pour avoir conscience de ma substantialité propre, il ne faudrait rien moins qu'avoir conscience de ce que les scolastiques appelaient mon aséité, mon existence par moi seul30. On définit la substance ce qui est véritablement en soi-même et non dans autre chose comme une simple qualité. Mais ce qui est en soi-même, Spinoza l'a bien compris, c'est ce qui est par soi-même, ce qui est cause de soi-même, ce qui est indépendant ou absolu. On a beaucoup critiqué cette définition de Spinoza; mais, en définitive, l'être qui ne contient en lui-même rien d'absolu, et qui n'est qu'un ensemble de relations et de dépendances, a-t-il le droit de dire qu'il existe individuellement et en lui-même? Que peut-il montrer, comme titre à l'existence, qui lui appartienne? A-t-il un droit de propriété véritable à faire valoir dans le domaine infini de l'être? ne pourrait-on pas montrer toujours que, s'il possède quelque chose à la surface, le sol lui-même et le fonds ne lui appartiennent point? Il est de par toutes les autres choses et non de par lui-même; en conséquence, il est en tout, plutôt qu'en lui-même. Il n'est pas plus pour soi que par soi et en soi. Ce sont là trois choses inséparables. La conscience de la vraie substantialité, la conscience de l'absolu, voilà ce qui pourrait constituer une vraie conscience de notre indépendance personnelle, de notre liberté, voyant en soi, a priori, la raison et la cause de tout ce qu'elle veut, de tout ce