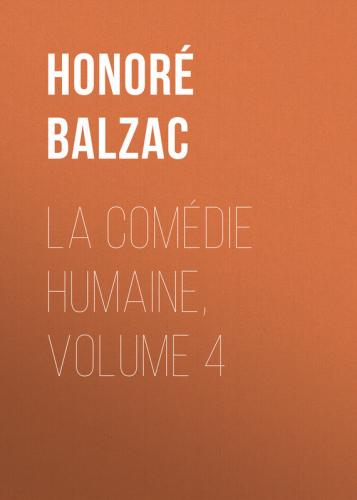La quatrième phase était donc commencée, celle de l'accoutumance, la dernière victoire de ces plans de campagne, et qui fait dire d'un homme par ces sortes de femmes: «Je le tiens!» Rochefide, qui venait d'acheter le petit hôtel au nom de mademoiselle Joséphine Schiltz, une bagatelle de quatre-vingt mille francs, en était arrivé, lors des projets formés par la duchesse, à tirer vanité de sa maîtresse qu'il nommait Ninon II, en en célébrant ainsi la probité rigoureuse, les excellentes manières, l'instruction et l'esprit. Il avait résumé ses défauts et ses qualités, ses goûts, ses plaisirs par madame Schontz, et il se trouvait à ce passage de la vie où, soit lassitude, soit indifférence, soit philosophie, un homme ne change plus, et s'en tient ou à sa femme ou à sa maîtresse.
On comprendra toute la valeur acquise en cinq ans par madame Schontz, en apprenant qu'il fallait être proposé longtemps à l'avance pour être présenté chez elle. Elle avait refusé de recevoir des gens riches ennuyeux, des gens tarés; elle ne se départait de ses rigueurs qu'en faveur des grands noms de l'aristocratie. « – Ceux-là, disait-elle, ont le droit d'être bêtes, parce qu'ils le sont comme il faut!» Elle possédait ostensiblement les trois cent mille francs que Rochefide lui avait donnés et qu'un bon enfant d'agent de change, Gobenheim, le seul qui fût admis chez elle, lui faisait valoir; mais elle manœuvrait à elle seule une petite fortune secrète de deux cent mille francs composée de ses bénéfices économisés depuis trois ans et de ceux produits par le mouvement perpétuel des trois cent mille francs, car elle n'accusait jamais que les trois cent mille francs connus. « – Plus vous gagnez, moins vous vous enrichissez, lui dit un jour Gobenheim. – L'eau est si chère, répondit-elle. – Celle des diamants? reprit Gobenheim. – Non, celle du fleuve de la vie.» Le trésor inconnu se grossissait de bijoux, de diamants, qu'Aurélie portait pendant un mois et qu'elle vendait après, de sommes données pour payer des fantaisies passées. Quand on la disait riche, madame Schontz répondait, qu'au taux des rentes, trois cent mille francs donnaient douze mille francs et qu'elle les avait dépensés dans les temps les plus rigoureux de sa vie, alors qu'elle aimait Lousteau.
Cette conduite annonçait un plan, et madame Schontz avait en effet un plan, croyez-le bien. Jalouse depuis deux ans de madame du Bruel, elle était mordue au cœur par l'ambition d'être mariée à la Mairie et à l'Église. Toutes les positions sociales ont leur fruit défendu, une petite chose grandie par le désir au point d'être aussi pesante que le monde. Cette ambition se doublait nécessairement de l'ambition d'un second Arthur qu'aucun espionnage ne pouvait découvrir. Bixiou voulut voir le préféré dans le peintre Léon de Lora, le peintre le voyait dans Bixiou qui dépassait la quarantaine et qui devait penser à se faire un sort. Les soupçons se portaient aussi sur Victor de Vernisset, un jeune poëte de l'école de Canalis, dont la passion pour madame Schontz allait jusqu'au délire; et le poëte accusait Stidmann, un jeune sculpteur, d'être son rival heureux. Cet artiste, un très joli garçon, travaillait pour les orfévres, pour les marchands de bronze, pour les bijoutiers, il espérait recommencer Benvenuto Cellini. Claude Vignon, le jeune comte de la Palférine, Gobenheim, Vermanton, philosophe cynique, autres habitués de ce salon amusant, furent tour à tour mis en suspicion et reconnus innocents. Personne n'était à la hauteur de madame Schontz, pas même Rochefide qui lui croyait un faible pour le jeune et spirituel La Palférine; elle était vertueuse par calcul et ne pensait qu'à faire un bon mariage.
On ne voyait chez madame Schontz qu'un seul homme à réputation macairienne, Couture qui plus d'une fois avait fait hurler les Boursiers; mais Couture était un des premiers amis de madame Schontz, elle seule lui restait fidèle. La fausse alerte de 1840 rafla les derniers capitaux de ce spéculateur qui crut à l'habileté du 1er mars; Aurélie, le voyant en mauvaise veine, fit jouer, comme on l'a vu, Rochefide en sens contraire. Ce fut elle qui nomma le dernier malheur de cet inventeur des primes et des commandites, une découture. Heureux de trouver son couvert mis chez Aurélie, Couture à qui Finot, l'homme habile, ou si l'on veut heureux entre tous les parvenus, donnait de temps en temps quelques billets de mille francs, était seul assez calculateur pour offrir son nom à madame Schontz qui l'étudiait, pour savoir si le hardi spéculateur aurait la puissance de se frayer un chemin en politique, et assez de reconnaissance pour ne pas abandonner sa femme. Couture, homme d'environ quarante-trois ans, très usé, ne rachetait pas la mauvaise sonorité de son nom par la naissance, il parlait peu des auteurs de ses jours. Madame Schontz gémissait de la rareté des gens capables, lorsque Couture lui présenta lui-même un provincial qui se trouva garni des deux anses par lesquelles les femmes prennent ces sortes de cruches quand elles veulent les garder.
Esquisser ce personnage, ce sera peindre une certaine portion de la jeunesse actuelle. Ici la digression sera de l'histoire.
En 1838, Fabien du Ronceret, fils d'un président de chambre à la cour royale de Caen mort depuis un an, quitta la ville d'Alençon en donnant sa démission de juge, siége où son père l'avait obligé de perdre son temps, disait-il, et vint à Paris dans l'intention de faire son chemin en faisant du tapage, idée normande difficile à réaliser, car il pouvait à peine compter huit mille francs de rentes, sa mère vivant encore et occupant comme usufruitière un très important immeuble au milieu d'Alençon. Ce garçon avait déjà, dans plusieurs voyages à Paris, essayé sa corde comme un saltimbanque, et reconnu le grand vice du replâtrage social de 1830; aussi comptait-il l'exploiter à son profit, en suivant l'exemple des finauds de la bourgeoisie. Ceci demande un rapide coup d'œil sur un des effets du nouvel ordre de choses.
L'égalité moderne, développée de nos jours outre mesure, a nécessairement développé dans la vie privée sur une ligne parallèle à la vie politique, l'orgueil, l'amour-propre, la vanité, les trois grandes divisions du Moi social. Les sots veulent passer pour gens d'esprit, les gens d'esprit veulent être des gens de talent, les gens de talent veulent être traités de gens de génie; quant aux gens de génie, ils sont plus raisonnables, ils consentent