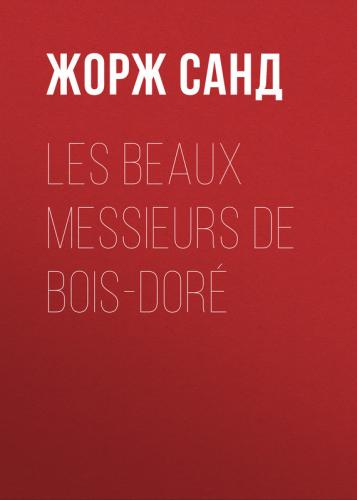PREMIER TOME
I
Parmi les nombreux protégés du favori Concini, don Antonio d'Alvimar, Espagnol d'origine italienne, qui signait Sciarra d'Alvimar, fut un des moins remarqués, et cependant un des plus remarquables par son esprit, son instruction et la distinction de ses manières. C'était un fort joli cavalier, dont la figure n'annonçait pas plus de vingt ans, bien qu'à cette époque il en déclarât trente. Petit plutôt que grand, robuste sans le paraître, adroit à tous les exercices, il devait intéresser les femmes par l'éclat de ses yeux vifs et pénétrants et par l'agrément de sa conversation, aussi légère et aussi charmante avec les belles dames qu'elle était nourrie et substantielle avec les hommes sérieux. Il parlait presque sans accent les principales langues de l'Europe, et n'était pas moins versé dans les langues anciennes.
Malgré toutes ces apparences de mérite, Sciarra d'Alvimar ne noua, dans les nombreuses intrigues de la cour de la régente, aucune intrigue personnelle; du moins, celles qu'il put rêver n'aboutirent pas. Il a avoué depuis, en intime confidence, qu'il eût voulu plaire à Marie de Médicis ni plus ni moins, et remplacer, dans les bonnes grâces de cette reine, son propre maître et protecteur, le maréchal d'Ancre.
Mais la balorda, comme l'appelait Léonora Galigaï, ne fit point d'attention au petit Espagnol et ne vit en lui qu'un mince officier de fortune, un subalterne sans avenir. S'aperçut-elle, au moins, de la passion feinte ou vraie de M. d'Alvimar? C'est ce que l'histoire ne dit pas et ce que d'Alvimar lui-même n'a jamais su.
Que, par son esprit et les agréments de sa personne, cet homme eût été capable de plaire si Concini n'eût pas occupé les pensées de la régente, c'est ce qu'il n'est pas impossible de supposer. Le Concini était parti de plus bas et n'était pas moitié si intelligent que lui. Mais d'Alvimar avait en lui-même un obstacle à la haute fortune des courtisans, un obstacle que son ambition ne pouvait vaincre.
Il était catholique exalté, et il avait tous les défauts des méchants catholiques de l'Espagne de Philippe II. Soupçonneux, inquiet, vindicatif, implacable, il avait pourtant la foi, mais une foi sans amour et sans lumière, une croyance faussée par les passions et les haines d'une politique qui s'identifiait avec la religion, «au grand déplaisir du Dieu bon et indulgent, dont le royaume n'est pas tant de ce monde que de l'autre,» c'est-à-dire, si nous comprenons bien la pensée de l'auteur contemporain de cette histoire, qui nous renseigne de temps en temps, le Dieu dont les conquêtes doivent s'étendre dans le monde moral par la charité, et non dans le monde des faits par la violence.
On ne saurait dire si la France n'eût pas subi quelque peu le régime de l'inquisition au cas où M. d'Alvimar se fût emparé du cœur et de l'esprit de la régente; mais il n'en fut pas ainsi, et Concini, dont tout le crime fut de n'être pas né assez grand seigneur pour avoir le droit de voler et piller autant qu'un grand seigneur véritable de ce temps-là, demeura, jusqu'à sa mort tragique, l'arbitre de la politique incertaine et vénale de la régente.
Après le meurtre du maréchal d'Ancre, d'Alvimar, qui s'était fort compromis à son service dans l'affaire du sergent de Paris1, fut forcé de disparaître pour n'être pas enveloppé dans le procès de la Léonora.
Il eût bien voulu se faufiler peu à peu dans le service du nouveau favori, le favori du roi, M. de Luynes; mais il ne sut pas s'y prendre; et, bien qu'il ne fût pas plus scrupuleux «qu'homme de cour de son temps, il sentit qu'il ne se pourrait ployer aux usages de la politique royale, qui voulait et devait céder bien des points aux calvinistes, chaque fois que l'on pouvait espérer d'acheter la soumission des princes qui exploitaient la religion des réformés au gré de leur ambition.»
Quand la reine Marie fut en disgrâce ouverte, Sciarra d'Alvimar crut de son intérêt de se montrer fidèle à sa cause. Il pensait que les partis ne sont jamais sans ressources et que tous ont leur jour. D'ailleurs, la reine, dût-elle rester dans l'exil, pourrait encore faire la fortune de ses affidés. Tout est relatif, et d'Alvimar était si pauvre, que les dons d'une personne royale, quelque ruinée qu'elle fût, étaient encore une belle chance pour lui.
Il s'employa donc pour aider à l'évasion du château de Blois, comme il s'était employé, quelques années auparavant, dans les troisièmes ou quatrièmes rôles des diverses comédies politiques suscitées tantôt par la diplomatie de Philippe III, tantôt par celle de Marie de Médicis, à l'effet de faire réussir les mariages2.
Ce M. d'Alvimar était, en général, suffisamment adroit pour le compte des autres, discret et apte au travail; mais on lui reprochait d'avoir la manie de donner son avis, «là où il se devait contenter de suivre celui des autres,» et de montrer une capacité dont il faut se résigner à laisser le mérite à «ses supérieurs, quand on n'est encore qu'un petit personnage.»
Il ne réussit donc pas, malgré son zèle, à attirer sur lui l'attention de la reine mère, et, lors de la retraite de Marie à Angers, il resta perdu dans les officiers subalternes, toléré plutôt qu'agréé.
D'Alvimar s'affecta de ces nombreux échecs. Rien ne lui servait, ni sa jolie figure, ni ses belles manières, ni sa naissance assez relevée, ni son savoir, sa pénétration, sa bravoure, sa causerie agréable ou instructive: «on ne l'aimait point.» Il plaisait tout d'abord, et puis, bien vite aussi, on se dégoûtait d'un fond d'amertume qu'il laissait tout à coup paraître; ou bien on se méfiait d'un fond d'ambition qu'il laissait mal à propos percer. Il n'était ni assez Espagnol ni assez Italien, ou bien, peut-être, il avait trop de l'un et de l'autre: un jour communicatif, persuasif et souple comme un jeune Vénitien; un autre jour, hautain, têtu et sombre comme un vieux Castillan.
À tous ses mécomptes se joignait un certain remords secret qu'il ne révéla qu'à sa dernière heure, et que nous verrons les événements de ce récit arracher de vive force à l'oubli où il voulait l'ensevelir.
Malgré nos recherches, nous le perdons de vue plus d'une fois dans les années qui s'écoulèrent entre la mort de Concini et la dernière année de la vie de Luynes; à l'exception de quelques mots de notre manuscrit sur sa présence à Blois et à Angers, nous ne trouvons, dans son histoire obscure et tourmentée, aucun fait digne de mention jusqu'à l'année 1621, où, pendant que le roi faisait si mal le siége de Montauban, le petit d'Alvimar était à Paris, toujours à la suite de la reine mère, réconciliée avec son fils après l'affaire des Ponts-de-Cé.
D'Alvimar avait alors renoncé à l'espoir de lui plaire, et peut-être bien lui aussi, dans son cœur «enfiélé,» la traitait-il de balourde, bien que, pour la première fois, elle eût fait preuve de bon sens en donnant sa confiance, et l'on dit son cœur, à Armand Duplessis; c'était là un rival que d'Alvimar ne devait pas beaucoup espérer d'éconduire. De plus, la reine, conseillée par Richelieu, tournait sa politique dans le même sens que Henri IV et Sully. Elle combattait, pour le moment, l'influence espagnole en Allemagne, et d'Alvimar se voyait presque en disgrâce, lorsque, pour surcroît de malheur, il lui arriva une assez méchante affaire.
Il se prit de querelle avec un autre Sciarra, un Sciarra Martinengo que Marie de Médicis employait plus volontiers, et qui refusait de le reconnaître pour parent. Ils se battirent: le Sciarra Martinengo fut grièvement blessé, et il vint aux oreilles de Marie que M. Sciarra d'Alvimar n'avait pas rigoureusement observé les lois du duel en France.
Elle le manda devant elle et le réprimanda avec beaucoup de brutalité; ce à quoi d'Alvimar répondit avec l'aigreur qui depuis longtemps s'amassait en lui. Il réussit à quitter Paris avant que l'on fût en mesure de l'y arrêter, et arriva, dans les premiers jours de novembre, au château d'Ars, en Berry, dans le duché de Châteauroux.
Il nous faut dire les raisons qui lui faisaient choisir ce refuge, de préférence à tout autre.
Environ six semaines avant son malheureux duel, M. Sciarra d'Alvimar s'était trouvé en relation de bonne compagnie avec M. Guillaume d'Ars, un jeune homme aimable et riche, descendant en droite ligne du brave Louis d'Ars, qui avait fait la belle retraite de Venouze en 1504, et qui fut tué à la bataille de Pavie.
Guillaume d'Ars avait été séduit par l'esprit de d'Alvimar et par la très-grande amabilité dont il était capable «à ses heures.» Il n'avait pas eu le temps de le connaître assez