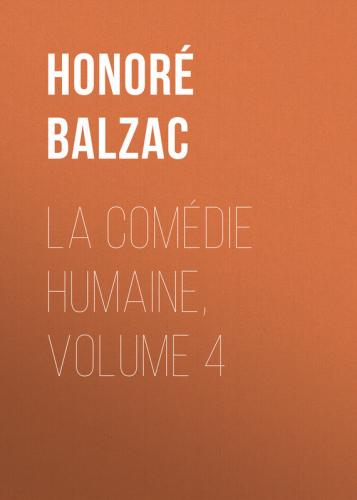Quelques jours après l'escapade de Béatrix, Arthur de Rochefide, devenu fils unique par suite de la mort de sa sœur, première femme du marquis d'Ajuda-Pinto, qui n'en eut pas d'enfants, se vit maître d'abord de l'hôtel de Rochefide, rue d'Anjou-Saint-Honoré, puis de deux cent mille francs de rente que lui laissa son père. Cette opulente succession, ajoutée à la fortune qu'Arthur possédait en se mariant, porta ses revenus, y compris la fortune de sa femme, à mille francs par jour. Pour un gentilhomme doté du caractère que mademoiselle des Touches a peint en quelques mots à Calyste, cette fortune était déjà le bonheur. Pendant que sa femme était à la charge de l'amour et de la maternité, Rochefide jouissait d'une immense fortune, mais il ne la dépensait pas plus qu'il ne dépensait son esprit. Sa bonne grosse vanité, déjà satisfaite d'une encolure de bel homme à laquelle il avait dû quelques succès dont il s'autorisa pour mépriser les femmes, se donnait également pleine carrière dans le domaine de l'intelligence. Doué de cette sorte d'esprit qu'il faut appeler réflecteur, il s'appropriait les saillies d'autrui, celles des pièces de théâtre ou des petits journaux par la manière de les redire; il semblait s'en moquer, il les répétait en charge, il les appliquait comme formules de critique; enfin sa gaieté militaire (il avait servi dans la Garde Royale) en assaisonnait si à propos la conversation, que les femmes sans esprit le proclamaient homme spirituel, et les autres n'osaient pas les contredire. Ce système, Arthur le poursuivait en tout; il devait à la nature le commode génie de l'imitation sans être singe, il imitait gravement. Ainsi, quoique sans goût, il savait toujours adopter et toujours quitter les modes le premier. Accusé de passer un peu trop de temps à sa toilette et de porter un corset, il offrait le modèle de ces gens qui ne déplaisent jamais à personne en épousant sans cesse les idées et les sottises de tout le monde, et qui, toujours à cheval sur la circonstance, ne vieillissent point. C'est les héros de la médiocrité. Ce mari fut plaint, on trouva Béatrix inexcusable d'avoir quitté le meilleur enfant de la terre, et le ridicule n'atteignit que la femme. Membre de tous les clubs, souscripteur à toutes les niaiseries qu'enfantent le patriotisme ou l'esprit de parti mal entendus, complaisance qui le faisait mettre en première ligne à propos de tout, ce loyal, ce brave et très sot gentilhomme, à qui malheureusement tant de riches ressemblent, devait naturellement vouloir se distinguer par quelque manie à la mode. Il se glorifiait donc principalement d'être le sultan d'un sérail à quatre pattes gouverné par un vieil écuyer anglais, et qui par mois absorbait de quatre à cinq mille francs. Sa spécialité consistait à faire courir, il protégeait la race chevaline, il soutenait une revue consacrée à la question hippique; mais il se connaissait médiocrement en chevaux, et depuis la bride jusqu'aux fers il s'en rapportait à son écuyer. C'est assez vous dire que ce demi-garçon n'avait rien en propre, ni son esprit, ni son goût, ni sa situation, ni ses ridicules; enfin sa fortune lui venait de ses pères! Après avoir dégusté tous les déplaisirs du mariage, il fut si content de se retrouver garçon, qu'il disait entre amis: – «Je suis né coiffé!» Heureux surtout de vivre sans les dépenses de représentation auxquelles les gens mariés sont astreints, son hôtel, où depuis la mort de son père il n'avait rien changé, ressemblait à ceux dont les maîtres sont en voyage: il y demeurait peu, il n'y mangeait pas, il y couchait rarement. Voici la raison de cette indifférence.
Après bien des aventures amoureuses, ennuyé des femmes du monde qui sont véritablement ennuyeuses et qui plantent aussi par trop de haies d'épines sèches autour du bonheur, il s'était marié, comme on va le voir, avec la célèbre madame Schontz, célèbre dans le monde des Fanny-Beaupré, des Suzanne du Val-Noble, des Mariette, des Florentine, des Jenny Cadine, etc. Ce monde, de qui l'un de nos dessinateurs a dit spirituellement en en montrant le tourbillon au bal de l'Opéra: – «Quand on pense que tout ça se loge, s'habille et vit bien, voilà qui donne une crâne idée de l'homme!» ce monde si dangereux a déjà fait irruption dans cette histoire des mœurs par les figures typiques de Florine et de l'illustre Malaga d'Une Fille d'Ève et de La Fausse Maîtresse; mais, pour le peindre avec fidélité, l'historien doit proportionner le nombre de ces personnages à la diversité des dénoûments de leurs singulières existences qui se terminent par l'indigence sous sa plus hideuse forme, par des morts prématurées, par l'aisance, par d'heureux mariages, et quelquefois par l'opulence.
Madame Schontz, d'abord connue sous le nom de la Petite-Aurélie pour la distinguer d'une de ses rivales beaucoup moins spirituelle qu'elle, appartenait à la classe la plus élevée de ces femmes dont l'utilité sociale ne peut être révoquée en doute ni par le préfet de la Seine, ni par ceux qui s'intéressent à la prospérité de la ville de Paris. Certes, le Rat taxé de démolir des fortunes souvent hypothétiques, rivalise bien plutôt avec le castor. Sans les Aspasies du quartier Notre-Dame de Lorette, il ne se bâtirait pas tant de maisons à Paris. Pionniers des plâtres neufs, elles vont remorquées par la Spéculation le long des collines de Montmartre, plantant les piquets de leurs tentes, soit dit sans jeu de mots, dans ces solitudes de moellons sculptés qui meublent les rues européennes d'Amsterdam, de Milan, de Stockholm, de Londres, de Moscou, steppes architecturales où le vent fait mugir d'innombrables écriteaux qui en accusent le vide par ces mots: Appartements à louer! La situation de ces dames se détermine par celle qu'elles prennent dans ces quartiers apocryphes; si leur maison se rapproche de la ligne tracée par la rue de Provence, la femme a des rentes, son budget est prospère; mais cette femme s'élève-t-elle vers la ligne des boulevards extérieurs, remonte-t-elle vers la ville affreuse de Batignolles, elle est sans ressources. Or, quand monsieur de Rochefide rencontra madame Schontz, elle occupait le troisième étage de la seule maison qui existât rue de Berlin, elle campait donc sur la lisière du malheur et sur celle de Paris. Cette femme fille ne se nommait, vous devez le pressentir, ni Schontz ni Aurélie! Elle cachait le nom de son père, un vieux soldat de l'empire, l'éternel colonel qui fleurit à l'aurore de ces existences féminines soit comme père, soit comme séducteur. Madame Schontz avait joui de l'éducation gratuite de Saint-Denis, où l'on élève admirablement les jeunes personnes, mais qui n'offre aux jeunes personnes ni maris ni débouchés au sortir de cette école, admirable création de l'Empereur à laquelle il ne manque qu'une seule chose: l'Empereur! – «Je serai là, pour pourvoir les filles de mes légionnaires,» répondit-il à l'observation d'un de ses ministres qui prévoyait l'avenir. Napoléon avait dit aussi: « – Je serai là!» pour les membres de l'Institut à qui l'on devrait ne donner aucun appointement plutôt que de leur envoyer quatre-vingt-trois francs par mois, traitement inférieur à celui de certains garçons de bureau. Aurélie était bien réellement la fille de l'intrépide colonel Schiltz, un chef de ces audacieux partisans alsaciens qui faillirent sauver l'Empereur dans la campagne de France, et qui mourut à Metz, pillé, volé, ruiné. En 1814, Napoléon mit à Saint-Denis la petite Joséphine Schiltz, alors âgée de neuf ans. Orpheline de père et de mère, sans asile, sans ressources, cette pauvre enfant ne fut pas chassée de l'établissement au second retour des Bourbons. Elle y fut sous-maîtresse jusqu'en 1827; mais alors la patience lui manqua, sa beauté la séduisit. A sa majorité, Joséphine Schiltz, la filleule de l'impératrice, aborda la vie aventureuse des courtisanes, conviée à ce douteux avenir par l'exemple fatal de quelques-unes de ses camarades, comme elle sans ressources, et qui s'applaudissaient de leur résolution. Elle substitua un on à l'il du nom paternel et se plaça sous le patronage de sainte Aurélie. Vive, spirituelle, instruite, elle fit plus de fautes que celles de ses stupides compagnes dont les écarts eurent toujours l'intérêt pour base. Après avoir connu des écrivains pauvres mais malhonnêtes, spirituels mais endettés; après avoir essayé de quelques gens riches aussi calculateurs que niais, après avoir sacrifié le solide à l'amour vrai, s'être permis toutes les écoles où s'acquiert l'expérience, en un jour d'extrême misère où chez Valentino, cette première étape de Musard, elle dansait vêtue d'une robe, d'un chapeau, d'une mantille d'emprunt, elle attira