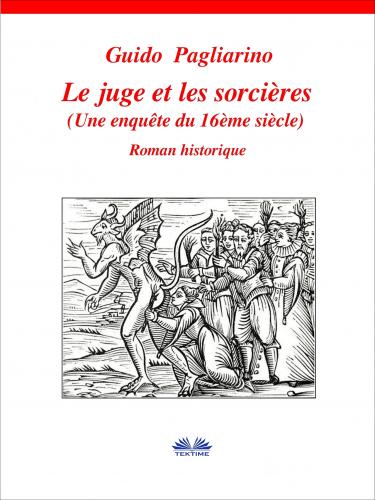Jâétais tellement convaincu du très grave danger que représentait la sorcellerie que, plus tard, en 1525, je publiai un Traité des Sortilèges, en guise dâillustration et dâavertissement. Cette Åuvre avait augmenté, hélas ! ma bonne réputation auprès de lâInquisition papale monastique. Au nom de la vérité, je dois néanmoins ajouter quâen exprimant mes doléances, je nâai pas voulu dire que les phénomènes diaboliques nâétaient ou ne soient, quâune simple apparence. Au contraire, moi-même, jâassistai une fois, en personne, glacé, à un phénomène de possession évident, que je raconterai plus loin ; câest certainement un procès, dont je parlerai aussi, qui compta les inculpés parmi les plus sûrs serviteurs de Satan. Je suis désormais convaincu cependant que, pour une grande partie, les sorcières et sorciers ne furent pas tels que je les vis et quâen conséquence, je me trompai presquâà chaque fois.
Chapitre II
Le doute commença à naitre cinq ans après la publication de mon livre.
Câétait le deuxième après-midi dâune journée tiède de fin dâhiver, qui finissait. Avant de prendre la direction de ma maison, à pieds comme de coutume, je mâétais arrêté au marché alimentaire et textile qui occupait toute la place du tribunal. Câétait lâheure à laquelle on commence à replier les tréteaux et à offrir la marchandise à meilleur prix. Je mâachetai une poularde vivante, que je fis occire et me lâemmenai à la maison en bandoulière, la tenant par les pattes de la main droite, tandis que de la gauche, je serrais la poignée de mon épée, comme à chaque fois que je paradais. Je voulais paraître fier et puissant, comme toujours, sans sembler embarrassé par ce volatile ; et, comme attendu, chacun mâavait salué de la main et autant du couvre-chef, tant sur la place que sur le reste du chemin, sauf ⦠Eh bien, un gamin méconnu et couvert de haillons trempés, qui, quand je fus presque arrivé au portail de ma maison, à défaut de sâêtre esquivé, mâavait même bousculé, sâencourant sans demander pardon, ignorant mon indignation : « Holà ! Holà ! ». Pire encore, alors quâil était éloigné de plusieurs enjambées et perdu dans la foule, jâavais dû subir de ce deux fois rien, le vil déshonneur dâune bruyante éructation. Ce nâest quâaprès que je compris que câétait le Ciel qui mâen voulait de mon arrogance et que câétait sans doute aussi un signe précurseur de la visite qui sâensuivit, peu de temps après ; mais au moment-même, jâétais meurtri. Une fois chez moi, dans mon appartement près du tribunal où jâhabitais seul avec un serviteur, je chassai ma colère en mâaspergeant la tête dâeau froide et le priai de veiller à ce que la poularde fût rôtie comme il le fallait. Ce nâétait pas la saison, sans quoi je lâeusse enjoint de la frire dans le jus de ce fruit tout nouveau que certains appellent la pomme dâor mais qui, une fois à maturité, est dâun rouge feu, si bien que, comme me lâavait expliqué un espion quelques mois auparavant, le petit peuple, qui, pour autant quâil sache que personne ne puisse lâentendre, a coutume dâappeler ce plat délicieux : « poulet à la diable » ou, dans le dialecte de la plèbe romaine, « er pollo a la dimonia »1 ; mais les experts en démonologie que jâavais immédiatement conviés à goûter ce mets avec le dernier scrupule, avaient, à plusieurs reprises, conclu que le démon nâavait pas élu domicile dans ce délicieux plat et que tout chrétien pouvait en manger sans pécher, fût-ce du bout des lèvres.
Jâenfilai ma robe de chambre à mon aise, je mâassis confortablement sur le banc de mon bureau en attendant le dîner et me préparais à reprendre la lecture de Roland Furieux, quand on frappa soudain à la porte.
Le serviteur mâannonça la visite de lâavocat Gianfrancesco Ponzinibio. Câétait lui lâauteur malfamé dâun traité contre la chasse aux sorcières, imprimé une dizaine dâannées plus tôt, que je nâavais pas lu mais que je connaissais par les attaques véhémentes du théologien dominicain et chasseur des serviteurs du damné Bartolomeo Spina, contenues dans son Quaestio de Strigibus, publié deux années après ce grimoire blasphémateur. Les critiques du moine avaient mis en danger le fol avocat, entre autre parce que Spina était un personnage important et un fonctionnaire écouté par le Medici de Milan qui, cette même année 1523, avait été élu pape sous le nom de Clément VII et qui lâavait promptement élevé au rang de cardinal puis, peu de temps après, à celui de Grand Inquisiteur,
Il faut dire aussi que je nâétais plus un magistrat béjaune et que, en tant que Juge Général, tout désormais mâétait soumis au sein du tribunal de Rome, après que je montai moi aussi dans lâestime de Clément, trois ans plus tôt. En effet, durant le grand sac de la Ville Eternelle provoqué par les conflits impériaux de 1527, je mâétais engagé, au risque de ma vie, à sauvegarder les documents des procès en cours et, autant que possible, ceux du passé. Selon moi, câétait précisément à cause de mon pouvoir au sein du tribunal que Ponzinibio sâétait adressé à moi ; et il en avait eu lâaudace parce que, désormais, il se faisait fort de la protection dâun autre dominicain, lâaustère monseigneur Gabriele Micheli, de vingt-sept ans à peine, mais plutôt savant, issu dâune famille puissante et très estimé dans la Ville.
Câest par respect pour lâévêque, qui, par-dessus tout et déjà en ce temps, avait la réputation dâun saint, que je reçus Ponzinibio.
Dans son traité, lâavocat avait nié la réalité des chevauchées volantes en balai ainsi que les sabbats, et condamné lâinstrument de torture comme outil pour obtenir des aveux. Eh bien, cela semble incroyable, cependant, à peine mâeût-il salué, comme il se devait, quâil commença : « Même vous, votre Seigneurie, vous avoueriez être un sorcier si on vous tenaillait les testicules avec des pinces embrasées ! »
Je mâen indignai profondément : comment osait-il me parler de la sorte, sans autre forme de politesse, sans le respect voulu, sans contour. Des pinces embrasées ! à moi ? « Soyez sûr mon bon seigneur », lui rétorquai-je le visage rembruni, mais dâune voix polie et sans me décontenancer le moins du monde, « que beaucoup de sorcières avouent non seulement sans avoir souffert la torture, mais avant même quâelles nâen soient menacées. » Jâavais exagéré, car seule Elvira sâétait comportée de la sorte, mais je rappelais que jâavais su fermement confirmer ma conscience, qui du reste, nâen avait pas vraiment besoin.
« Avec votre permission, très éminent juge », poursuivit le dameret, comme sâil nâavait rien entendu, « je remonterai encore de quelques siècles, pour mieux vous faire comprendre. »
Encore une impertinence ! Jâeus lâenvie de le faire chasser par mon serviteur, mais songeant à la noble et puissante figure de son protecteur, je me contins. »
« Revenons au début du dixième siècle », reprit-il, « a un manuscrit du moine Regino di Prüm, aujourdâhui dans les mains du sage monseigneur père Micheli, câest-à -dire à la transcription du Canon