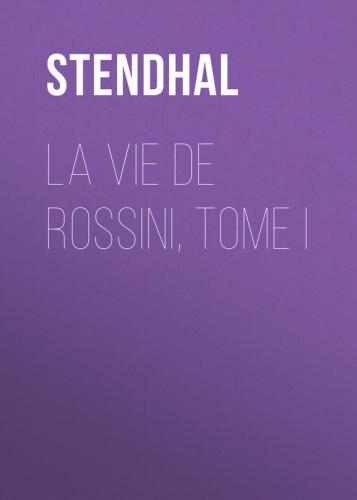Le bon Mayer, voyant un jour Cherubini à Venise, ne déguisait rien, et dit tout bonnement au copiste du théâtre: «Voilà la Faniska de Cherubini, vous allez copier depuis telle page jusqu'à telle autre.» C'était un morceau de vingt-sept pages, où il ne changea pas un bémol.
Mayer fut pour la musique ce que Johnson a été pour la prose anglaise; il créa un genre emphatique et lourd, qui s'écartait beaucoup du beau naturel, mais qui cependant n'était pas sans mérite, surtout une fois qu'on avait pu s'y accoutumer. Cette emphase a été cause que la réputation de Mayer a été anéantie par Rossini en un clin d'œil; c'est le sort qui attend toutes les affectations dans les arts. Le beau naturel paraît un jour, et l'on s'étonne d'avoir pu être dupe si longtemps. On voit que nos classiques ont bien leurs raisons pour empêcher qu'on ne joue Shakspeare, et pour lancer contre lui la jeunesse libérale. Le jour où l'on jouera Macbeth, que deviendront nos tragédies modernes?
Je crois qu'après Mayer, M. Paër, musicien né à Parme, malgré son nom allemand, est celui de tous les compositeurs de l'interrègne qui a eu le succès le plus européen. Cela tient peut-être à ce que M. Paër, outre un talent incontestable et très remarquable, est un homme très-fin, de beaucoup d'esprit, et fort agréable dans le monde. On dit qu'une des preuves les plus frappantes de cet esprit a été de tenir huit ans de suite Rossini caché aux Parisiens. Notez que s'il y eut jamais un homme fait pour plaire à des Français, c'est Rossini, Rossini le Voltaire de la musique.
Toutes les premières pièces de Rossini jouées à Paris, ont été montées d'une manière ridicule. Il me souvient encore de la première représentation de l'Italiana in Algeri. Lorsque peu après l'on donna la Pietra del Paragone, on eut l'attention de supprimer les deux morceaux qui ont fait la fortune de ce chef-d'œuvre en Italie: l'air Eco pietosa, et le finale sigillara. Il n'est pas jusqu'au chœur délicieux du second acte de Tancrède, chanté sur le pont, dans la forêt, par les chevaliers de Syracuse, qu'on n'ait trouvé prudent de raccourcir de moitié.
Le jour même où je fais transcrire cette page, je vois que l'on fait chanter le grand rôle bouffe de l'Italiana in Algeri par mademoiselle Naldi.
Un des premiers ouvrages de M. Paër est l'Oro fa Tutto (1793). Son premier chef-d'œuvre est la Griselda (1797). A quoi bon parler de cet opéra qui a fait le tour de l'Europe? Tout le monde connaît l'air délicieux chanté par le ténor. Tout le monde admire Sargine (1803). Je mettrais volontiers ces deux opéras au-dessus de tout ce qu'a fait M. Paër. L'Agnese ne me paraît pas du même rang; elle doit son succès européen à la facilité qu'il y a d'imiter d'une manière effrayante les fous, que personne ne se soucie d'aller étudier avec trop de détails dans les retraites affreuses où les place la pitié publique. L'âme profondément ébranlée par le spectacle horrible d'un père devenu fou parce que sa fille l'a abandonné, s'ouvre facilement aux impressions de la musique. Galli, Pelegrini, Ambrogetti, Zuchelli, ont été sublimes dans le rôle du fou. Ce succès ne m'empêche pas de croire que les beaux-arts ne doivent jamais s'emparer des sujets horribles. La charmante piété filiale de Cordelia me console de la folie de Lear (tragédie de Shakspeare); mais rien ne rend supportable pour moi l'état affreux où se trouve le père de l'Agnèse. La musique centuplant ma sensibilité, me rend cette scène horrible tout à fait insupportable. L'Agnese fait pour moi souvenir désagréable, et d'autant plus désagréable que le sujet est plus vrai. C'est comme la mort: on fera toujours peur aux hommes en leur parlant de la mort; mais leur en parler sera toujours une sottise ou un calcul de prêtre. Puisque la mort est inévitable, oublions-la.
La Camilla (1798), quoique devant en partie son succès à la mode de l'horreur qui, dans ce temps-là, nous valut les romans de madame Radcliffe, a cependant plus de mérite que l'Agnese; le sujet est moins horrible et plus tragique. Bassi, l'un des premiers bouffes de l'Italie, était excellent dans le rôle du valet, lorsque, couché entre les jambes de son maître, et chantant fort pour le réveiller, il lui crie:
Signor, la vita è corta,
Partiam per carità.
A tout moment dans cette pièce on trouve de la déclamation chantée, comme Gluck. C'est la plus triste chose du monde, cela est dur; or, dès qu'il n'y a pas douceur pour l'oreille, il n'y a pas musique.
Madame Paër, femme du compositeur, et fort bonne cantatrice, s'est toujours acquittée, en Italie, du rôle de Camille; elle y a eu les plus grands succès, et ces succès ont duré dix ans; je ne vois guère aujourd'hui que madame Pasta qui pût jouer Camille avec talent. Ce talent amènerait-il la vogue? Rossini nous a accoutumés à la surabondance des idées, Mozart à leur profondeur; il est peut-être bien tard pour la musique de Gluck.
Après MM. Mayer et Paër, les deux hommes célèbres de l'interrègne qui s'écoula entre Cimarosa et Rossini, il me reste à nommer quelques talents inférieurs. Je renvoie ces noms-là à l'appendice14.
IV
MOZART EN ITALIE
J'oubliais qu'il faut encore parler de Mozart, avant de nous occuper pour toujours, et exclusivement, de Rossini.
La scène musicale en Italie était occupée depuis dix ans par MM. Mayer, Paër, Pavesi, Zingarelli, Generali, Fioravanti, Weigl, et par une trentaine de noms plus ou moins oubliés aujourd'hui, et qui y régnaient tranquillement. Ces messieurs se croyaient les successeurs des Cimarosa et des Pergolèse, le public le croyait aussi; Mozart parut tout à coup comme un colosse au milieu de tous ces petits compositeurs italiens, qui n'étaient grands que par l'absence des grands hommes.
Mayer, Paër, et leurs imitateurs, cherchaient depuis longtemps à adapter le genre allemand au goût italien, et, comme tous les mezzo-termine, plaisant aux faibles des deux partis, ils avaient des succès flatteurs pour qui n'est pas difficile en admiration. Mozart, au contraire, comme tous les grands artistes, n'ayant jamais cherché qu'à se plaire à lui-même, et aux gens qui lui ressemblaient, Mozart, tel qu'un conspirateur espagnol, ne pouvait se flatter de prendre la société que par les sommités; ce rôle est toujours dangereux.
D'ailleurs, la présence personnelle lui manquait; il n'était pas là pour flatter les puissants, payer les journaux, et faire mettre son nom dans la bouche de la multitude: aussi n'a-t-il pénétré en Europe que depuis sa mort. Ses rivaux étaient présents, écrivaient leur musique pour les voix des acteurs, composaient de petits duos pour la maîtresse du prince, se conciliaient des protections; et cependant qu'est-ce aujourd'hui qu'une musique de Mayer ou de ***, à côté d'un opéra de Mozart? La position était inverse en Italie vers l'an 1800. Mozart était un barbare romantique, voulant envahir la terre classique des beaux-arts. Il ne faut pas croire que cette révolution, qui nous semble si naturelle aujourd'hui, se soit faite en un jour.
Mozart, encore enfant, avait fait deux opéras pour le théâtre de la Scala à Milan, Mitridate, en 1770, et Lucio Silla, en 177315. Ces opéras ne manquèrent pas de succès, mais il n'est pas probable qu'un enfant ait osé braver la mode. Quel qu'ait été le mérite de ces ouvrages, bientôt absorbés dans le torrent, guidé par Sacchini, Piccini, Paisiello, ces succès n'avaient laissé aucune trace.
Vers 1803, les triomphes de Mozart à Munich et à Vienne vinrent importuner les dilettanti d'Italie, qui d'abord refusèrent bravement d'y croire. Un barbare venir moissonner dans le champ des arts! On connaissait depuis longtemps ses symphonies et ses quatuors, mais Mozart faire de la musique pour la voix! On dit de lui ce que le parti des vieilles idées dit en France de Shakspeare: «C'est un sauvage qui ne manque pas d'énergie; on peut trouver quelques paillettes d'or dans le fumier d'Ennius; s'il eût eu l'avantage de prendre des leçons de Zingarelli et de Paisiello, il aurait peut-être fait quelque chose.» Et il ne fut plus question de Mozart.
En 1807, quelques Italiens de distinction, que Napoléon avait menés à sa suite, dans ses campagnes de 1805 et de 1806, et qui avaient passé par Munich, se mirent à reparler de Mozart: on se décida à essayer une de ses pièces,