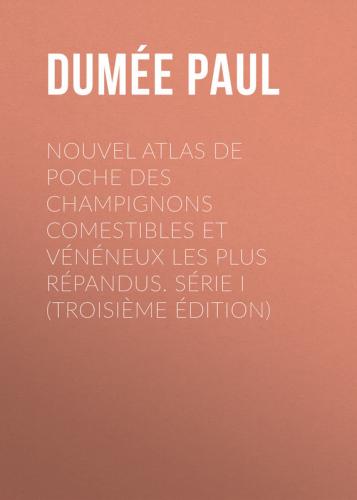PRÉFACE
Lorsqu'il y a quelques années nous avons fait paraître la première édition de notre Petit Atlas des Champignons comestibles et vénéneux, nous prévoyions qu'il répondait à un réel besoin. Malgré ses imperfections, notre petit volume s'est propagé sans bruit ni réclame, et deux éditions en ont consacré le succès.
Il fallut en prévoir une troisième; celle-ci pouvait, avec quelques retouches au texte et aux planches, être mise sur pied en quelques mois. Mais cela ne nous suffisait plus, nous voulions faire mieux et donner à notre volume un plus grand développement.
Instruit par l'expérience, nous avons de longue main préparé une transformation complète du «Petit Atlas» de 1895, en doublant presque le nombre des figures et en augmentant son texte. Aussi le Nouvel Atlasne ressemble-t-il en rien à l'ancien.
Estimant qu'on ne saurait jamais apporter assez de soins à un livre destiné à servir de guide à ceux qui recherchent les champignons au point de vue alimentaire, et que beaucoup de personnes se contentent (à tort), le plus souvent, de ne regarder que les images, nous avons voulu que celles-ci fussent d'une sincérité frappante et se rapprochent de la vérité absolue autant qu'on y peut arriver.
Il nous a fallu pour cela l'appui d'un éditeur complètement dévoué et compétent, et le concours d'un artiste de grand mérite. M. Bessin a bien voulu se charger de ce travail qui lui a demandé plusieurs années de soins assidus. Il semble, au premier abord, très simple de dessiner un champignon; eh bien, cela est une erreur, car les champignons sont des organismes essentiellement fugaces et inconstants; il est quelquefois très difficile de se procurer des échantillons typiques à différents états de développement, puisque, certaines années, les champignons sont rares, et les documents pris doivent attendre une saison plus favorable pour être complétés. Enfin, grâce à la patience de notre dessinateur, nous avons pu mener à bien la partie la plus difficile de notre tâche. Nous avons pu lui procurer, en bon état, toutes les espèces qui figurent dans notre livre. Toutes ont été peintes d'après nature; tous les dessins originaux ont été analysés, contrôlés, retouchés, pour les amener à un état voisin de la perfection.
De plus, nos champignons ont été représentés, autant que possible, dans le milieu où ils se plaisent le plus volontiers, ce qui, nous en sommes persuadé, ne déplaira pas à nos lecteurs.
Il ne faudrait pas croire qu'après ce travail, déjà si laborieux, tout soit fini. C'est à partir de ce moment qu'intervient l'éditeur qui veut faire reproduire ces peintures dans toute leur exactitude. Que de démarches, que d'essais infructueux, avant d'arriver à un résultat satisfaisant! Il faut avoir été mêlé quelque peu à ces préliminaires pour pouvoir apprécier son dévouement.
On se figure généralement qu'un éditeur n'a qu'à recevoir de son auteur le manuscrit à reproduire: c'est une grande erreur, et l'on peut dire que le succès d'un livre, et surtout d'un livre à images, dépend, en grande partie, du soin que prend son éditeur de lui donner sa forme définitive.
Pour nous, nous sommes intimement persuadé que si notre Nouvel Atlas des Champignons comestibles et vénéneux a quelque succès, il le devra surtout à ses magnifiques planches qui n'eussent pas été indignes d'un cadre plus grand, ce qui en eût privé de nombreux amateurs.
Meaux, avril 1905.
PRÉFACE DE LA 2e ÉDITION
En moins de quatre ans plusieurs milliers d'exemplaires de notre Nouvel Atlas ont été enlevés, sans compter plusieurs tirages des planches faits pour divers pays étrangers.
Cela nous encourage à publier une série II qui paraîtra dans environ deux ans, et avec des planches non moins réussies que celles de la première.
Dans la présente édition il a été fait quelques additions au texte; on y trouvera aussi un intéressant chapitre sur le Traitement des empoisonnements par les champignons, dû à M. le docteur F. GUÉGUEN que nous recommandons à l'attention de nos lecteurs.
Paris, juillet 1909.
Comment nos planches ont été reproduites
Il y a peu de nos lecteurs qui n'aient entendu parler de procédés de reproduction, de photogravure, du système des trois couleurs, mais ce sont des idées encore bien confuses dans le public.
Jadis, on ne pouvait obtenir des planches en couleur qu'en les coloriant au pinceau, à la main, avec plus ou moins d'art et d'exactitude: c'était long et coûteux. C'est de cette époque que datent les ouvrages à deux prix, l'un pour l'édition avec planches noires, l'autre pour l'édition avec planches coloriées.
Le besoin d'obtenir des images en couleur à bon compte, surtout des gravures de mode, amena la création du coloriage au patron. Ce procédé consiste à découper autant de plaques en métal très mince qu'il y a de couleurs dans le sujet, et à appliquer celles-ci avec une brosse-pinceau sur les parties laissées à jour sur l'épreuve en noir. C'est expéditif et relativement économique, mais ne permet aucun modelé, à moins de faire de coûteuses retouches au pinceau.
Puis vint la Chromolithographie. Un artiste appelé chromiste décompose par l'œil le sujet destiné à être imprimé en couleurs, et redessine chacune d'elles sur une pierre préparée à cet effet; autant de nuances, autant de pierres; il en faut quinze, vingt et au delà, et fatalement l'artiste, suivant sa manière de comprendre les couleurs et le nombre de tirages affectés à une reproduction, s'écarte souvent de l'original en l'interprétant à sa manière.
La Photogravure vint ensuite, qui consiste à reproduire un objet par la photographie, à décalquer cette dernière sur une plaque de métal bien plane, à l'y fixer et à obtenir des reliefs par des bains acide successifs, après en avoir isolé le dessin par une matière résistant à l'action de l'acide.
Ce procédé mécanique, rapide et très économique, ne tarda pas à faire disparaître la gravure sur bois et à permettre de joindre des illustrations à des livres et à des journaux auxquels la lente et coûteuse gravure sur bois n'était pas accessible.
Mais on n'était encore qu'au simple trait, c'est-à-dire au noir sur blanc. Les demi-teintes que la lithographie et la gravure sur bois pouvaient rendre admirablement, n'étaient point encore permises à la Zincogravure, appelée ainsi parce que le zinc est le métal généralement employé pour ce procédé.
La Similigravure apparut à son tour. Au moyen d'une trame très fine placée dans l'appareil photographique entre l'objectif et la plaque sensible, de façon à laisser sur celle-ci les traces de la trame, on parvient à obtenir ces gradations ou demi-teintes indiquées par un quadrillé qui brise le trait, enlève la netteté du dessin, mais permet d'utiliser une photographie sans intervention du dessinateur. La préparation des clichés en similigravure demande beaucoup plus de soins que pour ceux au trait, aussi la similigravure est-elle sensiblement plus coûteuse.
Jusqu'ici la «chromolitho» triomphe encore; survient alors une application d'un procédé déjà connu dans d'autres genres de gravure: le grain de résine. Une fine poudre de résine étalée sur le métal, puis chauffée pour la rendre adhérente donne, après traitement par les acides, un relief analogue au trait; cette opération, plusieurs fois répétée avec des grains de résine agglomérés fins ou desserrés, donne facilement des gradations successives depuis l'a plat jusqu'aux nuances les plus fines, et permet de combiner un trait non brisé, comme c'est le cas en similigravure, avec les demi-teintes de celles-ci, mais non la reproduction directe de la photographie.
Le grain de résine ne tarda pas à être appliqué aux couleurs d'une façon analogue à ce qui se pratique en chromolithographie. C'est encore un chromiste qui, avec ses yeux, décompose le sujet en autant de couleurs qu'il veut ou doit en employer. Seulement là où, en «litho», il faut une pierre